L'actualité paie RH, sociale et juridique des entreprises
Tenez vous informé des dernières évolutions et restez connecté !


Externalisation de la paie : Les avantages indéniables pour votre entreprise
Dans un contexte où la compétitivité et l’efficacité sont essentielles, externaliser la paie est devenu une solution stratégique pour de nombreuses entreprises. Déléguer cette mission permet de se concentrer sur la croissance et le développement, tout en confiant la gestion des salaires à des experts.
Réduction des coûts, gain de temps, conformité légale et sécurité des données : la sous-traitance de la paie offre des avantages indéniables pour les TPE, PME comme pour les grandes entreprises.
Comprendre l’externalisation de la paie
L’externalisation de la paie consiste à confier la gestion des salaires, déclarations sociales et obligations réglementaires à un prestataire spécialisé.
Cela inclut :
- la collecte et le traitement des données des salariés,
- le calcul des salaires et des cotisations sociales,
- la génération et distribution des bulletins de paie,
- la mise en conformité avec la législation en vigueur.
En choisissant un prestataire, l’entreprise se libère d’une tâche chronophage et minimise les risques liés aux erreurs de paie ou à la non-conformité. Selon vos besoins, elle peut prendre la forme d’une paie totalement externalisée ou d’une paie copilotée, avec un accompagnement partiel.
Les avantages concrets de l’externalisation de la paie
1. Réduction des coûts
Plus besoin d’investir dans des logiciels coûteux, la formation continue ou le recrutement d’un gestionnaire de paie interne. L’externalisation permet de réaliser des économies substantielles.
2. Gain de temps et productivité
En confiant la paie à des spécialistes, les équipes RH peuvent se concentrer sur des missions stratégiques : recrutement, fidélisation des talents, gestion des compétences.
3. Sécurité et conformité
Les experts paie suivent en temps réel les évolutions légales et sociales. Cela garantit la conformité avec la législation (URSSAF, DSN, conventions collectives…). De plus, la confidentialité et la sécurité des données sont renforcées, en conformité avec le RGPD. Pour aller plus loin, nos équipes réalisent également des audits réglementaires RH. Et pour les cas particuliers comme les arrêts maladie, référez-vous à notre fiche pratique sur le maintien de salaire légal.
4. Limitation des erreurs
Une erreur de paie peut coûter cher à l’entreprise (sanctions, litiges, baisse de motivation des salariés). Un prestataire spécialisé engage sa responsabilité sur l’exactitude des bulletins de paie. Certaines erreurs concernent directement les retenues sur rémunération : découvrez notre fiche pratique sur la saisie sur salaire.
5. Continuité de service
En interne, un départ ou une absence peut bloquer tout le processus. Avec un prestataire, la continuité est garantie : vos salariés reçoivent leur paie sans interruption.
Externalisation de la paie : TPE, PME et grandes entreprises
- Petites entreprises : un moyen de gagner du temps et de se concentrer sur la croissance.
- PME : une solution flexible pour mieux gérer les ressources humaines et les coûts.
- Grandes entreprises : un outil pour rationaliser les processus et harmoniser la gestion sociale à grande échelle.
Pour un accompagnement administratif complet, nous proposons aussi l’externalisation de l’administration du personnel.
Choisir le bon prestataire de paie
Le succès d’une externalisation dépend du partenaire choisi. Vérifiez :
- son expertise dans votre secteur,
- ses références et certifications,
- ses outils technologiques (portail RH, tableaux de bord, reporting),
- sa capacité à fournir un accompagnement personnalisé.
Un bon prestataire doit être un partenaire stratégique, et pas seulement un exécutant.
Conclusion : une solution gagnante pour toutes les entreprises
L’externalisation de la paie n’est plus seulement une option pratique : c’est un levier de performance. Elle permet de sécuriser vos obligations sociales, d’optimiser vos coûts et de recentrer vos ressources sur votre cœur de métier.
Chez Paie & RH Solutions, nous proposons des services de gestion de paie adaptés à toutes les tailles d’entreprise, avec un haut niveau d’expertise et de personnalisation.
👉 Externalisez votre paie et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment : le développement de votre entreprise.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

Comment gérer les absences des salariés en cas d’intempéries
Les intempéries (tempête, verglas, chutes de neige…) peuvent parfois perturber la routine professionnelle, amenant les salariés à arriver en retard voire à manquer le travail. On parle dans ce cas de force majeure.
Comment l’employeur gère-t-il ces absences ?
En principe, pas de paiement du salaire
Lorsqu’un salarié ne peut se rendre à son travail en raison des intempéries, l’employeur n’a pas l’obligation de le payer sauf dispositions conventionnelles contraires.
Il peut ainsi effectuer une retenue sur salaire. Cette dernière sera proportionnelle à la durée de travail du salarié.
Par exemple, un salarié travaillant 35 heures hebdomadaires à hauteur de 7 heures quotidiennes verra une retenue sur sa paye de 7 heures en cas d’absence d’une journée.
Les moyens qu’a l’employeur pour éviter la retenue
L’employeur peut proposer d’autres solutions à ses salariés de manière à ne pas les pénaliser sur leur fiche de paie. Ainsi il peut :
- Aménager les horaires des salariés
- Proposer aux salariés de télétravailler
- Leur permettre de poser un jour de congés payés, de RTT ou de repos compensateur
- Répartir les heures d’absence sur les autres jours de la semaine
En outre, l’employeur peut également avoir recours à l’activité partielle de droit commun fondée sur le motif de « Sinistres ou intempéries de caractère exceptionnel ». Cette solution permet une réponse collective.
Cas particulier du BTP
Le BTP est plus susceptible que les autres secteurs à subir les conditions météorologiques.
Aussi, a été créé un régime d’indemnisation particulier : les congés intempérie BTP.
Nous vous invitons à consulter notre fiche pratique pour tout comprendre ce régime particulier.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

Gérer les infractions routières des salariés
Que cela soit dans le cadre de leurs fonctions, pour se rendre au travail ou même dans leur vie personnelle, les salariés sont susceptibles de commettre des infractions routières pouvant entraîner des répercussions sur leur contrat de travail. Toutefois, chaque situation peut donner lieu à des solutions différentes. Nous vous en disons plus !
Gérer une infraction routière commise durant le temps de travail du salarié
Un salarié effectuant des déplacements professionnels peut commettre des infractions au code de la route durant son temps de travail.
Dénonciation du salarié et règlement de l’amende
Lorsque la société met à disposition un véhicule au salarié qui commet une infraction, la personne recevant l’amende est le représentant légal de cette société titulaire de la carte grise.
Toutefois, selon la nature de l’infraction, l’employeur peut avoir l’obligation de donner l’identité du conducteur (nom, prénom, adresse et référence du permis) aux autorités compétentes dans les 45 jours à compter de l’envoi ou la remise de l’avis de contravention. Cela concerne les infractions constatées par un appareil de contrôle automatique (RADAR mobiles ou fixes) et mentionnées à l’article R310-11 du code de la route.
Si l’employeur ne dénonce pas le salarié ayant commis l’infraction, il est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 3750€. En outre, il ne pourra pas récupérer le montant de l’amende qu’il aura réglé à la place du salarié.
Sanctions possibles
L’employeur peut tout à fait sanctionner le salarié qui enfreint le code de la route dans le cadre de l’exécution du son contrat de travail.
L’échelle de la sanction dépendra bien évidemment de la nature de l’infraction et de son aspect répétitif. Elle pourra aller du simple avertissement au licenciement pour faute grave ou lourde.
Par exemple, un salarié se voyant retirer son permis après avoir été déclaré positif aux produits stupéfiants durant son temps de travail pourra être licencié pour faute grave.
Gérer une infraction routière commise en dehors du temps de travail
La situation est plus délicate à gérer. En effet, un fait intervenant dans le cadre de la vie personnelle du salarié ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire par l’employeur. Toutefois, il arrive qu’une infraction routière intervenue hors temps de travail cause un trouble à l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur peut prendre des mesures pouvant aller jusqu’au licenciement.
Si l’infraction n’a pas d’incidence sur les obligations contractuelles du salarié
L’employeur ne peut pas sanctionner un salarié pour une infraction routière commise en dehors du temps de travail et ce, même si le véhicule appartient à la société.
Si l’infraction a une incidence sur les obligations contractuelles du salarié
Il peut arriver que l’infraction routière commise en dehors du temps de travail par un salarié entraîne des conséquences sur la réalisation de ses obligations professionnelles.
Ainsi, un salarié qui perd son permis de conduire alors que ses fonctions nécessitent la conduite d’un véhicule entraîne un trouble au fonctionnement de l’entreprise. Cela vise par exemple les conducteurs routiers, les VRP ou les ouvriers du bâtiment devant se rendre sur les différents chantiers de l’entreprise.
L’employeur devra tenter de reclasser le salarié à un poste ne nécessitant pas la conduite d’un véhicule.
Si cela s’avère impossible, il pourra suspendre temporairement le contrat de travail du salarié le temps que ce dernier récupère son permis ou bien envisager un licenciement.
Attention, dans ce dernier cas il ne s’agit pas d’un licenciement disciplinaire mais d’un licenciement pour trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise. Ce licenciement donnera lieu au versement d’une indemnité de licenciement. En revanche, le préavis ne sera pas dû par le salarié puisqu’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

Congés payés : la révolution !
4 arrêts de la Cour de cassation ont apporté des nouveautés importantes concernant l’acquisition des congés payés dans le cas d’un arrêt maladie, le report des congés acquis en cas de congé parental d’éducation et la date de déclenchement de la prescription triennale.
Révolution concernant l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie
Les salariés acquièrent désormais des droits à congés payés pendant leurs arrêts de travail d’origine non professionnelle suite à un arrêt de la Cour de cassation rendu le 13 septembre 2023.
De la même manière, l’acquisition des droits à congés payés pour les accidents du travail et maladie professionnelle n’est désormais plus limitée à la durée d’un an.
Enfin, pendant cette période d’arrêt maladie, le salarié peut acquérir l’intégralité de ses droits à congés payés soit 5 semaines au lieu des 4 prévues par la directive européenne.
La problématique de l’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie est désormais nettement simplifiée : quelque soit l’arrêt de travail, quelque soit sa durée, les salariés continuent d’acquérir leurs congés payés pendant un arrêt maladie !
Compte tenu de l’absence de précisions données et du flou juridique relatif à cette décision, nous préconisons l’application de cette jurisprudence de la manière suivante :
- Le salarié étant en arrêt maladie à compter du 14/09/2023 : acquisition normale des CP
- Le salarié dont l’arrêt maladie se termine avant le 14/09/2023 : application de l’ancienne règle
- Le salarié en arrêt du 01/09/2023 au 30/09/2023 : application au prorata
- 01/09/2023 -> 14/09/2023 : application de l’ancienne règle
- 14/09/20233 -> 30/09/2023 : acquisition normale des CP
Rappelons que le salarié qui avait été absent pour maladie pendant 4 semaines ou moins pendant la période de référence bénéficiait déjà de la totalité de ses congés payés.
Report des congés payés acquis avant un congé parental d’éducation
Les congés payés acquis non pris avant un congé parental d’éducation doivent désormais être reportés selon la Cour de cassation dans un arrêt du 13 septembre 2023.
En cas de congé parental d’éducation à temps complet, les congés payés acquis et non pris avant le congé parental d’éducation étaient perdus au motif que c’était le salarié qui décidait de ses dates de départ en congé parental d’éducation.
Désormais, l’impossibilité de prendre les congés payés acquis du fait d’un congé parental d’éducation entraîne le report obligatoire des congés payés acquis à la date de reprise du travail.
Une prescription triennale pour congés bouleversée
Si la prescription triennale applicable aux congés payés en elle-même n’est pas modifiée, il n’en est pas de même de sa date de déclenchement.
En effet, depuis un arrêt du 13 septembre 2023, cette prescription ne commence à courir qu’à compter du moment où le salarié a pu être en mesure de poser ses congés payés.
Vous voulez en savoir plus sur les congés payés ?
Téléchargez notre fiche pratique rédigée par nos experts.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

L’impact des absences sur les jours de repos des salariés en forfait-jours
Une question qui revient souvent est l’impact des absences – notamment maladies – sur le nombre de jours de repos dont bénéficie un salarié en forfait-jours. Nous vous en disons plus dans cet article !
Le principe : les absences n'impactent pas les jours de repos
Par principe, les heures perdues ne sont pas récupérables sauf cas prévus explicitement par la loi. C’est le cas des interruptions collectives de travail suivantes :
- Cause accidentelles, intempéries ou cas de force majeure
- Inventaire
- Chômage d’un ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire
Ainsi, dès lors que nous ne sommes dans l’une des trois situations ci-dessus, l’employeur a l’interdiction de demander au salarié de rattraper son absence (maladie, congé sans solde, absence non justifiée…).
Cette règle s’applique également aux salariés en convention de forfait-jours.
Ainsi, le retrait d’un jour de repos afin de compenser un jour d’absence non récupérable d’un salarié au forfait-jours est prohibé.
L'exception : l'accord collectif peut prévoir une règle différente
Il existe toutefois une exception au fait que les absences n’impactent pas le nombre de jours de repos d’un salarié en forfait-jours : l’accord collectif.
En effet, l’accord collectif mettant en place le forfait jour peut prévoir que l’acquisition des jours de repos se fait en fonction du temps de travail effectif dans l’année.
Dans ce cas, le fait de faire perdre un jour de repos en cas de maladie n’est pas considéré comme une récupération interdite de l’absence maladie mais découle du moyen d’acquisition des jours de repos.
Attention toutefois, la majorité des accords collectifs ne fonctionne pas de cette manière. Par principe le nombre de jours de repos se déduit non pas du temps de travail effectif dans l’année mais selon le nombre de jours « travaillables » dans l’année et sont établis à l’avance. La pratique permettant de diminuer le nombre de jours de repos induit une organisation et un suivi beaucoup plus important que la règle classique.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement des forfaits-jours, vous pouvez consulter notre dossier spécial sur le temps de travail.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)


.svg)
.svg)
.svg)
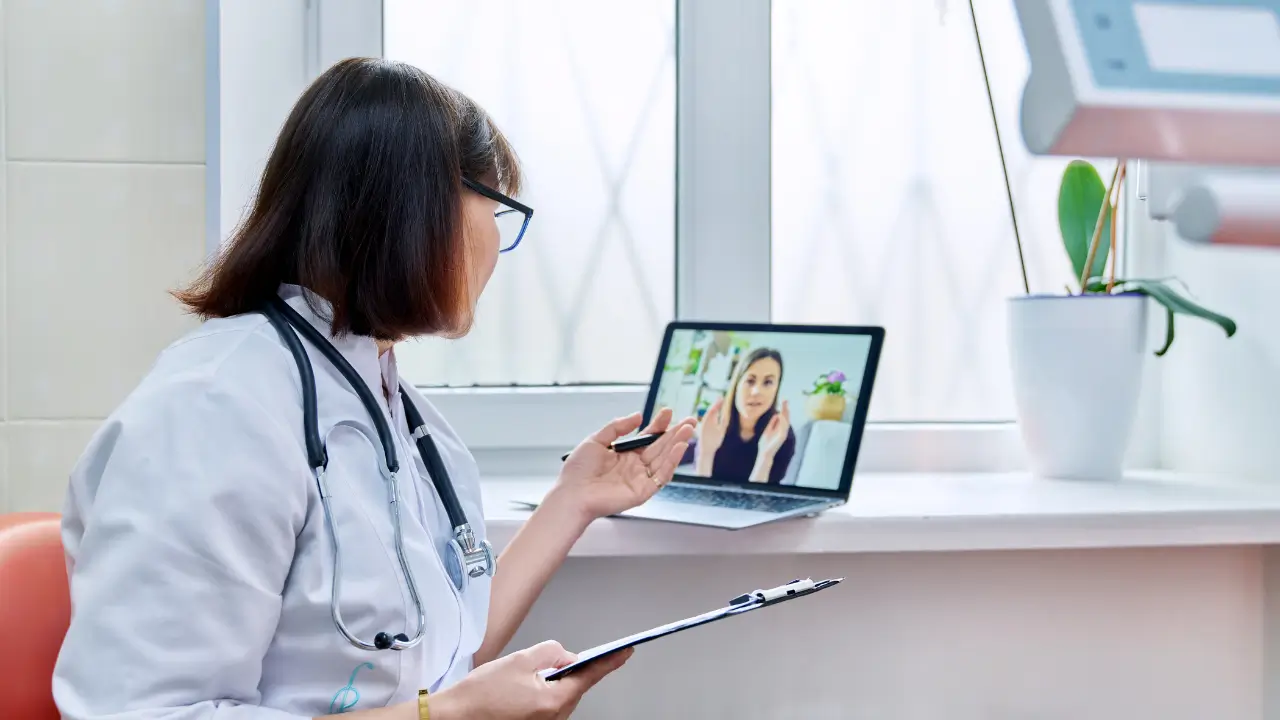










.svg)
