L'actualité paie RH, sociale et juridique des entreprises
Tenez vous informé des dernières évolutions et restez connecté !


Les principales mesures de la loi de finances rectificative 2022
Destinée à améliorer le pouvoir d’achat des salariés, la loi de finances rectificative a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat. Elle a été publiée au Journal officiel le 17 août 2022.
Voici les principales mesures à retenir :
1. Heures supplémentaires et RTT
- La limite d’exonération d’impôt sur le revenu pour la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires est relevée de 5 000 € à 7 500 €, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
- Un dispositif permet aux salariés de racheter des jours de RTT acquis entre 2022 et 2025.
2. Frais de transport domicile – travail
- La limite d’exonération d’impôt sur le revenu pour la « prime transport » et le forfait mobilités durables passe de 500 € à 700 €, dont 400 € pour les frais de carburant (contre 200 € auparavant). Cette mesure s’applique pour les années 2022 et 2023.
- Les conditions d’éligibilité à la prime transport sont assouplies et il est désormais possible de cumuler la prime transport avec le remboursement de 50 % des abonnements de transports publics.
- La part facultative de la prise en charge des abonnements de transports publics par l’employeur est exonérée jusqu’à 25 % supplémentaires. Concrètement, 75 % du coût total de l’abonnement peut être exonéré pour 2022 et 2023.
3. Titres-restaurant
- La participation patronale exonérée passe de 5,69 € à 5,92 € par titre-restaurant.
- Les allocations forfaitaires pour frais de repas sont également revalorisées (montant fixé par décret). Ces mesures s’appliquent à partir du 1er septembre 2022.
4. Activité partielle
- Les salariés considérés comme « personnes vulnérables » pourront être placés en activité partielle. Les modalités pratiques doivent être précisées par décret.
- Cette possibilité est ouverte du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

Les principales mesures protection du pouvoir d’achat
Destinée à améliorer le pouvoir d’achat des salariés, la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat. Elle a été publiée au Journal officiel le 17 août 2022.
Voici un résumé des principales mesures prévues par ce texte :
1. Prime de partage de la valeur
La loi confirme la mise en place de la prime de partage de la valeur, successeur de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. (Voir notre dossier spécial dédié).
2. Heures supplémentaires et jours de repos
Pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés :
- Une déduction forfaitaire des cotisations patronales s’applique sur les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er octobre 2022. Le montant précis doit être fixé par décret.
- Une déduction forfaitaire est également prévue pour les jours de repos rachetés au-delà de 218 jours dans le cadre des forfaits-jours.
3. Intéressement
Pour les entreprises de moins de 50 salariés :
- Possibilité de mettre en place un accord par décision unilatérale de l’employeur, sous conditions.
- La durée maximale d’un accord est fixée à 5 ans.
- La procédure de contrôle est assouplie et raccourcie pour les accords déposés à compter de 2023.
- La mise en place peut se faire de manière dématérialisée.
- Le renouvellement par tacite reconduction devient possible plusieurs fois.
- Le congé paternité et d’accueil de l’enfant est désormais assimilé à une période de présence pour le calcul de l’intéressement.
4. Titres-restaurant
Jusqu’au 31 décembre 2023, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour payer en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit directement consommable ou non.
5. Négociation collective de branche
Deux nouveautés sont prévues :
- En cas de non-respect du SMIC, un risque de fusion des branches professionnelles est possible.
- En cas de hausses fréquentes du SMIC, une procédure simplifiée d’extension des avenants relatifs aux salaires pourra être mise en place.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

La loi santé au travail
La nouvelle loi sur la santé au travail a été publiée au JO le 03/08/2021 et entre en application le 31/03/2022. Des décrets ont également été publiés ces dernières semaines pour préciser certains points. On vous résume toutes les nouveautés !
1. Le DUERP
Un contenu renforcé
En plus de répertorier tous les risques professionnels auxquels les salariés sont exposés dans le cadre de leur travail, le DUERP devra assurer la traçabilité collective de ces expositions.
Des obligations selon l’effectif de la société ont été rajoutées :
- les entreprises d’au moins 50 salariés devront rédiger un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Un calendrier de mise en œuvre devra être élaboré ;
- les entreprises de moins de 50 salariés devront définir les actions de prévention des risques et de protection des salariés dans le DUERP.
Le CSE devra être consulté pour le DUERP et ses mises à jour.
Durée de conservation du DUERP
Les entreprises devront conserver le DUERP dans toutes ses versions, pour une durée d’au moins 40 ans à compter du 01/03/2022.
Création d’un dépôt dématérialisé
Afin de simplifier la conservation, le DUERP et ses mises à jour feront l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique. Ce dépôt sera applicable au 01/07/2023 pour les entreprises d’au moins 150 salariés et au plus tard le 01/07/2024 pour les autres.
Une mise à jour modifiée
La mise à jour annuelle ne concernera plus les entreprises de moins de 11 salariés à compter du 31/03/2022.
Toutefois, ces entreprises devront continuer d’actualiser le DUERP en cas :
- de décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
- lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur.
L’actualisation du DUERP concerne également le programme annuel de prévention et la liste des actions de prévention.
Mise à disposition du DUERP élargie
Le DUERP devra être « tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès ».
2. LE SUIVI MÉDICAL
Création d’un rendez-vous pour les longs arrêts
Création d’un nouveau rendez-vous facultatif entre le salarié et l’employeur et associant le SPST (ex-SST). Il concernera les arrêts de travail supérieurs à une durée de 30 jours.
Ce rendez-vous permettra d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention et de la désinsertion professionnelle mais également d’un examen de pré-reprise et de mesures d’aménagement du poste et du temps de travail.
Visites de pré-reprise et de reprise
A compter du 31/03/2022, l’examen de pré-reprise sera obligatoire pour tout arrêt de travail dépassant 30 jours.
La visite de reprise pour les absences pour maladie ou accident non professionnels ne devra être organisée qu’à partir du 60 jours d’absence (contre 30 jours actuellement).
Dans les deux situations, cela s’appliquera aux arrêts de travail commençant après le 31/03/2022.
Visites de mi-carrière
Création d’une visite permettant d’évaluer l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du salarié ainsi que des risques de désinsertion professionnelle.
Elle sera organisée durant l’année civile des 45 ans du salarié (ou à une autre échéance prévue dans un accord de branche). Il est possible de l’anticiper dans les 2 ans précédant l’échéance prévue.
Possibilité pour la médecine du travail de proposer un aménagement du poste ou du temps de travail.
Aménagement de la visite de fin de carrière
A compter du 31/03/2022, cette visite interviendra dans les meilleurs délais après la fin d’exposition au risque ayant justifié la surveillance renforcée.
Si le risque persiste jusqu’à la fin de carrière du salarié, cette visite interviendra avant le départ en retraite.
Mise à disposition du DUERP élargie
Le DUERP devra être « tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès ».
3. AUTRES MESURES
Dialogue social
Intégration de la qualité des conditions de travail et de la qualité de vie au travail dans la négociation sur l’égalité professionnelle
CPF de transition
Les salariés en risque de désinsertion (salariés absents pour une durée minimale de 6 mois, consécutifs ou non, au cours des 24 mois précédents pour maladie/accident d’origine professionnels ou non), auront accès au CPF de transition sans condition d’ancienneté minimale.
Passeport prévention
Création au plus tard au 1er octobre 2022 d’un passeport recensant les attestations, les certificats et les diplômes obtenus par le salarié durant les formations relatives à la santé et à la sécurité au travail.
Lutte contre la désinsertion professionnelle
Création de deux dispositifs afin de faciliter le retour à l’emploi après un arrêt de travail : la Convention de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE) et l’essai encadré.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

Pour tout savoir sur le guide repère
Le 15 mars 2022, le Ministère du travail a publié un « guide repère » qui vient préciser les mesures de prévention des risques de contamination au covid-19.
Ce guide remplace le protocole sanitaire qui imposait jusque-là le port du masque obligatoire, les distanciations sociales, etc.
Nous résumons pour vous le contenu de ce guide et les mesures de protection à poursuivre.
Quels sont les principes généraux du guide à respecter?
Les mesures principales de protection à poursuivre sont les suivantes :
- les mesures d’hygiène (lavage des mains régulier, éternuer dans son coude…)
- Le fait de continuer à aérer les locaux régulièrement
- le nettoyage des objets et points de contact que les salariés sont amenés à toucher
-
Que faire en cas d'un cas contact ou d'un cas positif?
Les règles d’isolement doivent s’appliquer.
A noter qu’à compter du 21 mars 2022, les personnes cas contact (hors personnes immunodéprimées) ne devront plus respecter une période d’isolement, quel que soit leur schéma vaccinal.
Quelle protection pour les salariés vulnérables?
Ces personnes peuvent reprendre leur activité en présentiel mais leur employeur doit leur garantir des mesures de protections renforcées.
Dans certains cas, les personnes vulnérables ne pouvant télétravailler pourront bénéficier de l’activité partielle.
Le guide repère renvoie à la FAQ du Ministère de la santé.
L'employeur a-t-il l'obligation d'évaluer les risques d'exposition au Covid-19 ?
Tout employeur est tenu d’évaluer les risques professionnels, le risque d’exposition des salariés au Covid-19 en faisant partie.
A noter que l’employeur n’est toujours pas tenu de désigner un référent Covid même si cela est recommandé.
Qu'en est-il de la vaccination?
La vaccination est toujours fortement conseillée. Celle-ci peut se faire par les services de santé au travail si le salarié le demande.
Pour rappel, le personnel travaillant dans des établissements de soin restent soumis à l’obligation vaccinale.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

Réactivation de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement pour les secteurs impactés par les restrictions sanitaires
L’exonération de cotisations et l’aide au paiement des cotisations pour aider les secteurs impactés par les dernières restrictions sanitaires « Covid-2 » ont été réactivées par un décret du 14 mai 2022
Pour rappel, le dispositif « Covid 2 » concerne l’exonération totale de cotisations et contributions sociales patronales et l’aide au paiement des cotisations sociales, égale à 20% du montant des rémunérations brutes versées aux salariés.
Entreprises concernées
Pourront bénéficier de ce dispositif les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :
- Dans les secteurs S1 : les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de l’évènementiel, de la culture du sport (y compris les clubs sportifs professionnels), de la culture et du transport aérien ;
- Dans les secteurs S1 bis : ceux dont l’activité dépend de celle des secteurs S1.
Les discothèques et autres salles de danse ne sont plus concernées.
Conditions pour bénéficier de l’aide
Pour bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations, ces employeurs doivent, au cours du mois au titre duquel l’exonération est applicable :
- soit avoir fait l’objet d’une interdiction totale d’accueil du public ;
- soit avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 65 % par rapport au chiffre d’affaires du même mois de l’une des deux années précédentes, ou au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ou de l’année 2020 ou, pour les entreprises créées en 2021, par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2021.
Lorsque la baisse du chiffre d’affaires, constatée dans les conditions ci-dessus, est d’au moins 30% mais inférieure à 65%, les employeurs pourront seulement bénéficier de l’aide au paiement des cotisations sociales.
Le contenu du dispositif
L’exonération des cotisations patronales et l’aide au paiement des cotisations sociales peuvent être appliquées à l’ensemble des salariés, quel que soit le montant de leur rémunération. Toutefois, cela ne concerne que la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le SMIC en vigueur au titre du mois considéré.
Ce dispositif n’est applicable que sur les cotisations sociales et les rémunérations qui ne font pas l’objet d’une compensation au titre de l’aide « renfort » qui a été mise en œuvre par le décret du 4 janvier 2022, pour les mêmes périodes.
L’exonération des cotisations : les cotisations concernées
- assurances sociales (maladie, vieillesse) et allocations familiales ;
- accidents du travail et maladies professionnelles (au maximum, 0,69 point) ;
- solidarité pour l’autonomie ;
- pôle emploi ;
- contribution au fonds national d’aide au logement (FNAL).
Les cotisations de retraite complémentaire ne seront donc pas exonérées.
Cette exonération se calcule sans limite au niveau de la rémunération.
Cette exonération se calculera sur les cotisations restant dues après application de réductions de charges « classiques », notamment :
- « réduction générale de cotisations » (dite « réduction Fillon),
- toute autre exonération totale ou partielle de cotisations,
- taux spécifiques,
- montants forfaitaires de cotisations.
Mandataires sociaux
Les mandataires sociaux, qui sont « assimilés salariés », des entreprises de moins de 250 salariés éligibles à ce dispositif, peuvent bénéficier d’une réduction de cotisations et de contributions qui sont dues au titre des années 2021 et 2022.
Elle s’impute en priorité sur les cotisations et contributions sociales qui sont dues au titre de l’année 2021. Lorsque le montant de réduction est supérieur au montant de cotisations et contributions dues au titre de cette année, le surplus s’imputera sur le montant dû au titre de l’année 2022.
Pour chaque mois d’éligibilité au titre duquel le mandataire social est rémunéré par l’entreprise, cette réduction est plafonnée et peut atteindre :
- 600 € si l’entreprise a subi une fermeture administrative ;
- 600 € si la baisse du chiffre d’affaires est d’au moins 65% par rapport au chiffre d’affaires du même mois de l’une des deux années précédentes, au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ou de l’année 2020 ou, pour les entreprises créées en 2021, par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2021 ;
- 300 € si la baisse du chiffre d’affaires, constatée dans les conditions ci-dessus, est d’au moins 30% et inférieure à 65%.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)


.svg)
.svg)
.svg)
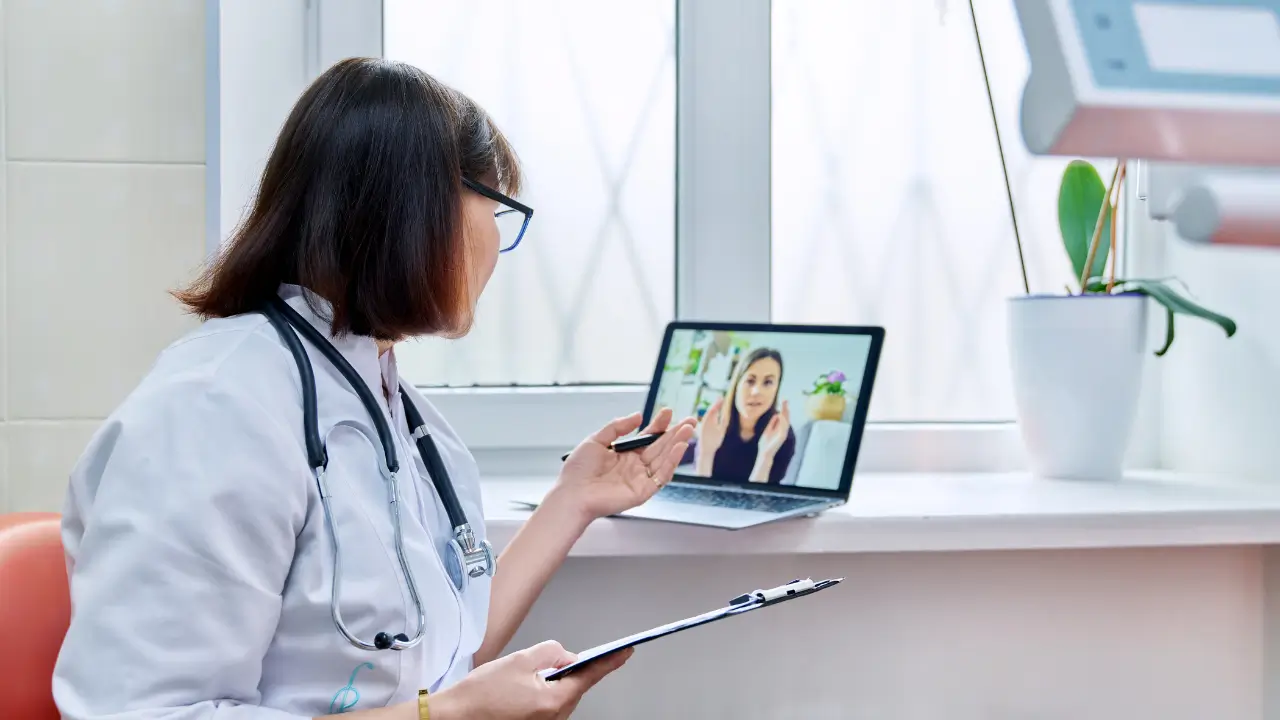










.svg)
