L'actualité paie RH, sociale et juridique des entreprises
Tenez vous informé des dernières évolutions et restez connecté !


Répartition du solde de la taxe d’apprentissage
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2022, la taxe d’apprentissage est collectée par l’URSSAF et depuis le 25 mai 2023, les employeurs peuvent rediriger les fonds versés aux URSSAF au titre du solde de la taxe d’apprentissage vers des établissements bénéficiaires de leur choix via la plateforme SOLTéA.
Le 22 mai 2025, la plateforme SOLTéA est venue préciser son calendrier pour cette année 2025.
Qu’est-ce que le solde de la taxe d’apprentissage ?
En dehors de l’Alsace-Moselle, la taxe d’apprentissage est calculée à un taux de 0,68%, composé de deux parties distinctes :
- La première partie, soit 0,59%, est déclarée mensuellement via la DSN et versée aux URSSAF selon les mêmes échéances que les cotisations de sécurité sociale.
- La seconde partie, représentant un solde de 0,09%, est payée et déclarée annuellement aux URSSAF, en même temps que les cotisations de sécurité sociale du mois d’avril de l’année suivante.
Il est possible pour les employeurs de consacrer la fraction de 0,09% du « solde » à des dépenses visant à soutenir des formations initiales technologiques et professionnelles (en dehors de l’apprentissage) ainsi que l’insertion professionnelle et ce via la plateforme SOLTéA.

Utilisation de la plateforme SOLTéA pour rediriger le solde de la taxe d’apprentissage
Le gouvernement a ouvert la plateforme SOLTéA permettant ainsi aux employeurs qui le souhaitent de choisir des établissements bénéficiaires spécifiques et de diriger tout ou partie des sommes qu’ils ont versées aux URSSAF au titre de leur fraction « solde » de taxe d’apprentissage. On parlera de « flécher les fonds ».
Une fois les fonds versés aux URSSAF, la Caisse des dépôts et consignations se charge de procéder aux versements aux établissements désignés par les employeurs, conformément à leurs instructions. Elle a notamment pour responsabilité de :
- Définir les modalités d’utilisation de la plateforme ;
- Mettre à disposition une liste des établissements et formations habilités vers lesquels les employeurs peuvent diriger tout ou partie des sommes versées aux URSSAF pour la fraction « solde » de 0,09% ;
- Informer les employeurs de la bonne réception des fonds versés aux établissements choisis
- Informer les employeurs n’ayant pas dirigé tout ou parti du solde des critères de répartition par défaut qui seront utilisés par la Caisse des dépôts pour allouer ces montants ;
- Verser les fonds fléchés par les employeurs aux établissements bénéficiaires ;
- Communiquer chaque année aux employeurs la date d’ouverture du service.
Que se passe-t-il en cas de sommes non fléchées ?
La Caisse des dépôts et consignations se charge de répartir ces fonds en fonction de deux critères :
- Une partie des fonds est répartie en fonction de la localisation géographique des employeurs et des établissements habilités, tels qu’indiqués dans les listes régionales établies par le préfet. Les établissements d’une même région reçoivent un montant identique provenant du solde de la taxe d’apprentissage.
- Une autre partie des fonds est répartie au niveau national en fonction de la nature des formations. Cette répartition vise à soutenir les formations qui répondent aux besoins de recrutement les plus importants dans chaque région, en raison d’un manque de personnes qualifiées. Un montant identique est attribué aux établissements pour chaque formation concernée.
Un arrêté détermine la répartition entre ces deux parties, garantissant que chaque part représente au moins 20% des fonds à distribuer. Cette même règle s’applique en cas d’impossibilité pour la Caisse des dépôts de verser la fraction solde (ex : mauvaise coordonnées bancaires, cessation d’activité l’établissement bénéficiaire…).
Quel est le nouveau calendrier pour affecter le solde de la taxe d’apprentissage ?
Calendrier 2025 – répartition du solde via SOLTéA
- Déclaration en DSN + paiement à l’URSSAF : 05 ou 15/05/2025
- Ouverture 1ʳᵉ fenêtre d’affectation : 26/05/2025
- Échéance 1ʳᵉ fenêtre : 27/06/2025
- 1er versement CDC des fonds fléchés : à partir du 11/07/2025
- Ouverture 2ᵉ fenêtre d’affectation : 14/07/2025
- Échéance 2ᵉ fenêtre : 24/10/2025
- 2ᵉ versement CDC des fonds fléchés : à partir du 07/11/2025
- 3ᵉ versement CDC des fonds fléchés (jusqu’au 9 novembre) : à partir du 27/11/2025
(CDC = Caisse des dépôts et consignations)
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

APLD Rebond : un nouveau levier pour sécuriser l’emploi
Dans un contexte économique incertain, la loi de finances pour 2025 a posé les bases d’un nouveau dispositif venant remplacer l’Activité partielle de longue durée (APLD) : l’activité partielle de longue durée Rebond (APLD-R).
Pour rappel, l’APLD « ancienne version » n’est plus accessible aux nouveaux demandeurs depuis 2023.
Officiellement lancé par le décret du 14 avril 2025, ce mécanisme permet ainsi aux entreprises fragilisées par une baisse durable d’activité, mais dont la pérennité n’est pas compromise, de rebondir tout en sécurisant l’emploi et les compétences de leurs équipes.
Un dispositif conçu pour durer
L’APLD-R s’adresse aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui, sans remettre en cause leur pérennité, nécessite un ajustement des horaires de travail.
Elles peuvent ainsi diminuer l’horaire de leurs salariés, en contrepartie d’engagements solides en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle des salariés concernés par l’APLD-R.
Le dispositif est accessible pour les demandes de validation ou d’homologation transmises entre le 1er mars 2025 et le 28 février 2026.
Attention : il ne permet pas d’individualiser la baisse d’activité au sein d’un même service ou d’un même établissement, il s’applique collectivement.
Comment mettre en œuvre l’APLD Rebond ?
Deux voies s’offrent aux employeurs :
- Négocier un accord au niveau de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe qui devra être validé par l’Administration ;
- Élaborer un document unilatéral basé sur un accord de branche étendu qui devra par la suite être homologué auprès de l’Administration.
A savoir que le silence de l’Administration sous 15 jours (validation) ou 21 jours (homologation) vaut acceptation.
Dans tous les cas, l’accord ou le document unilatéral doit être rigoureux et comporter des mentions obligatoires : diagnostic économique, liste des salariés concernés, engagements sur la réduction du temps de travail, actions de formation prévues…
Chaque détail compte et conditionne la décision de l’administration d’accepter ou de refuser le dispositif à l’entreprise demandeuse.
Quelles sont les règles en matière de réduction du temps de travail ?
La réduction de l’horaire de travail ne peut excéder 40 % de la durée légale, sauf circonstances exceptionnelles où elle pourrait atteindre 50 % après autorisation de l’Administration.
Ce taux est apprécié par salarié sur l’ensemble de la période d’application du dispositif, limitée à 18 mois d’activité réduite (consécutifs ou non) sur 24 mois.
Une indemnisation avantageuse pour soutenir salariés et employeurs
L’APLD Rebond prévoit une compensation attractive :
- Pour les salariés : 70 % du salaire brut (environ 84 % du net), voire 100 % lorsqu’ils suivent une formation durant leurs heures chômées.
- Pour les employeurs : une allocation équivalente à 60 % du salaire brut.
Les indemnités sont plafonnées à une rémunération de 4,5 SMIC (soit 37,42 €/h pour les salariés et 32,08 €/h pour les employeurs en 2025) et ne peuvent pas être inférieures à 9.40€ tant pour les salariés que pour les employeurs.
Engagements, contrôles… et obligations renforcées
L’adhésion à l’APLD-R s’accompagne d’exigences précises :
- Maintenir l’emploi des salariés concernés.
- Favoriser la montée en compétences via des formations adaptées et financées.
- Informer régulièrement le CSE et, au besoin, justifier des mesures prises.
L’Administration contrôle rigoureusement chaque étape : mise en place, renouvellement et clôture du dispositif.
Un bilan détaillé est exigé à chaque renouvellement et à la fin de l’APLD-R. Le respect des engagements conditionne non seulement la poursuite du dispositif, mais aussi le maintien des allocations perçues.
Ainsi, en cas de manquement, l’Administration peut refuser les aides ou en exiger le remboursement.
Conclusion
L’APLD Rebond offre aux entreprises un outil structurant pour surmonter des difficultés passagères sans compromettre leur avenir.
En contrepartie, elle impose des obligations fortes de préservation de l’emploi et de développement des compétences, inscrivant ainsi cette mesure dans une logique de sécurisation des parcours professionnels. L’enjeu est double : soutenir les entreprises tout en investissant dans l’avenir des salariés.
Une fiche pratique détaillant tout ce qu’il y a savoir sur ce dispositif (notamment en ce qui concerne le contenu de l’accord ou du document unilatéral) ou encore l’articulation avec l’activité partielle est en cours de rédaction.
Nous vous informerons de sa date de mise en ligne prochaine qui devrait intervenir dans le courant du mois de mai.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

Nouveautés Sociales 2025 pour la gestion de la paie et des RH
Retour sur les principales nouveautés sociales 2025 à ne pas manquer dans :
- La loi de finances pour 2025 (LF) publiée au JO le 15.02.2025
- La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (LFSS) publiée au JO le 28.02.2025
👉 On vous explique tout !
👉 Retrouvez également les chiffres clés de l’année 2025 (SMIC, plafond de la sécurité sociale, avantage en nature repas…).
I – Les nouveautés sociales RH
Loi de finances pour 2025
- Frais domicile/lieu de travail : reconduction de l’exonération pour 2025 de la prise en charge des titres d’abonnement aux transports publics jusqu’à 75% de la valeur du titre
- Monétisation des RTT : prolongation jusqu’au 31/12/2026 du dispositif de rachat des jours de RTT. Pour maîtriser vos obligations en matière de temps de travail et de repos, référez-vous à notre fiche pratique sur les durées de travail.
- Pourboires volontaires : reconduction pour 2025 de l’exonération fiscale et sociale des pourboires volontaires
- Activité partielle de longue durée rebond : base légale pour ce nouveau dispositif qui devra être précisé dans un futur décret
- (EDIT : ce décret a été publié au JO le 15/04/2025)
- Apprentissage :
- l’accord de branche peut moduler le taux de prise en charge des formations à distance à compter du 16/02/2025
- obligation pour l’employeur de participer au financement des formations de niveau bac +3 et plus proposées par les CFA à compter d’un futur décret (qui précisera le montant de la prise en charge). Pour mieux comprendre les dispositifs actuels, consultez notre fiche pratique sur le contrat de professionnalisation et l’apprentissage.
- CPF : les actions de formation d’accompagnement et de conseil pour les créateurs ou repreneurs d’entreprises (ACRE) non répertoriées au RNCP ou au répertoire spécifique ne sont plus éligibles au CPF. Retrouvez les conditions complètes dans notre fiche pratique dédiée au Compte Personnel de Formation.
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
- Effectifs ETP : à compter du 01/01/2025, les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs ne comptent ni pour le groupement (sauf pour la tarification AT/MP), ni pour l’entreprise d’accueil
II – Les nouveautés sociales cotisations sociales et URSSAF
Loi de finances pour 2025
- Zones France Ruralités Revitalisation (ZFRR) : pour les communes anciennement ZRR qui n’ont pas été classées en ZFRR, application de l’exonération de cotisations sociales des ZFRR du 01/07/2024 au 31/12/2027
- Bassin d’emploi à redynamiser (BER) : exonération de cotisations sociales pour les entreprises s’implantant dans un BER jusqu‘au 31/12/2027
- Versement mobilité : possibilité pour les régions de métropole (hors Île-de-France) ainsi que la collectivité de Corse d’instaurer un versement mobilité spécifique sur leur territoire, dans la limite d’un taux de 0,15 %
- Taxe d’apprentissage : les mutuelles ne sont plus exonérées de la taxe d’apprentissage à compter du 01/03/2025
- Taxe sur les salaires : en cas d’adhésion à un assujetti unique en matière de TVA, exonération de la taxe sur les salaires.
- Cette mesure s’appliquera aux rémunérations versées à partir de 2026.
- Pour bénéficier de cette exonération, deux conditions devront être remplies à compter du 1er janvier 2026 :
- L’employeur ne doit pas être assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre d’un assujetti unique TVA.
- L’année précédant le versement des rémunérations, au moins 90 % du chiffre d’affaires taxable à la TVA de l’assujetti unique doit correspondre à des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA.
- Contribution au dialogue social : réécriture des dispositions du Code du travail mais aucun changement en pratique
- Indemnités de rupture liées à un PSE : exonération totale d’impôt sur le revenu de l’indemnité versée en cas d’annulation de la décision d’un PSE
- Bon de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) :
- fin du traitement fiscal uniforme des BSPCE : distinction entre le gain d’acquisition et le gain de cession pour les titres souscrits à compter du 01/01/2025
- impossibilité d’inscrire sur un plan d’épargne (PEE/PEI/PERCO) les titres attribués ou exercés à compter du 10/10/2024
- Management packages (ManPack) jusqu’au 31/12/2027 :
- gain net exclu de l’assiette de CSG/CRDS sur les revenus d’activité et de cotisations sociales
- fraction du gain net imposé selon le régime des plus-values entre dans l’assiette de CSG sur les revenus du patrimoine (= hors paie)
- contribution libératoire de 10% sur la fraction du gain net imposée à l’IR (= hors paie)
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Abaissement des plafonds ouvrant droit à réduction de taux
- Assurance maladie : abaissement de 2.5 SMIC à 2.25 SMIC
- Allocations familiales : abaissement de 3.5 SMIC à 3.3 SMIC
👉 La valeur du SMIC à retenir depuis le 1er janvier 2025 est de 11,88 € de l’heure, soit 1 801,84 € par mois pour 151,67 heures de travail.
Ainsi, pour un salarié à temps plein, présent tout le mois, les seuils sont :
- 4 054,14 € pour la cotisation maladie (1 801,84 × 2,25)
- 5 946,07 € pour la cotisation famille (1 801,84 × 3,3)
Réduction générale de cotisations patronales (RGCP)
- Plafond : fixé à 1,6 SMIC, soit 34 595,28 € annuels pour un salarié à temps plein présent l’année entière
- PPV intégrée : la prime de partage de la valeur est intégrée dans le calcul de la réduction générale dès 2025, que ce soit en direct ou placée sur un plan d’épargne (tolérance pour départ avant le 01/03/2025)
- Valeur T du coefficient : ajustée au 1er mai 2025
- AT/MP max pris en compte = 0,50 %
- cotisation chômage = 4 %
- Nouvelles valeurs :
- 0,3193 pour les entreprises < 50 salariés (Fnal 0,10 %)
- 0,3233 pour les entreprises ≥ 50 salariés (Fnal 0,50 %)
Réduction de taux (2026)
- À compter du 01/01/2026, suppression du mécanisme de réduction sur les cotisations maladie et allocations familiales.
- Reconfiguration de la réduction générale (seuil porté de 1.6 à 3 SMIC).
Apprentis
- Baisse des exonérations pour contrats conclus à compter du 01/03/2025 :
- cotisations salariales exonérées jusqu’à 50 % du SMIC (au lieu de 79 %)
- CSG/CRDS exonérées dans la limite de 50 % du SMIC (au lieu de 100 %)
- Précision BOSS :
- la date de conclusion du contrat fait foi (et non la date de début d’exécution)
- la rémunération de référence est celle avant abattement de 1.75 %
- Tolérance prévoyance complémentaire :
- si rémunération < 50 % du SMIC → exonérée de CSG/CRDS
- si rémunération > 50 % du SMIC → soumise à CSG/CRDS
- Taxe sur les salaires : fraction de rémunération assujettie à CSG/CRDS soumise à la taxe sur les salaires pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 01/03/2025 (exonération pour les entreprises < 11 salariés). Pour sécuriser vos calculs et éviter les erreurs déclaratives, consultez notre fiche pratique sur le traitement de la CSG-CRDS sur les salaires.
- Cumul avec réduction heures sup : les exonérations se cumulent avec la réduction de cotisations salariales des heures supplémentaires.
- Exemple : apprenti rémunéré 1 700 € dont 200 € d’heures sup (11,76 %).
- Dépassement de 799 € par rapport à 50 % du SMIC → réduction calculée sur base de 93,96 € × 11,31 % = 10,63 €.
Autres mesures
- Attribution gratuite d’actions (AGA) : contribution patronale portée à 30 % dès le 01/03/2025
- Exonération TO-DE agricole :
- pérennisation du dispositif
- extension aux CUMA et coopératives de conditionnement de fruits/légumes
- exonération maximale jusqu’à 1,25 SMIC
- JEI et JEC :
- JEI : seuil de dépenses R&D porté à 20 %
- JEC : fourchette portée à 5–20 %
- (exercices clos à partir du 01/03/2025)
- Accidents du travail (AT/MP) : indemnisation révisée → intégration du déficit fonctionnel permanent
- Sécurité juridique des cotisants : extension du champ d’opposabilité des circulaires auprès de l’URSSAF + nouvelle base législative pour le BOSS
Lutte contre les fraudes
- Validation par l’URSSAF de l’immatriculation au RNE des entreprises étrangères sans établissement stable en France
- Transmission possible aux employeurs d’éléments de fraude IJSS par les CPAM/URSSAF
- Interdiction des plateformes délivrant uniquement des arrêts de travail via questionnaire/autodiagnostic
- Interdiction des actes de télémédecine réalisés depuis l’étranger pour délivrer des arrêts de travail
- Extension du droit de communication URSSAF :
- lutte contre la fraude hors contrôle
- lutte contre le travail dissimulé
- Résultats des enquêtes opposables entre organismes de contrôle
- Extension de l’opposition à tiers détenteur aux sommes indûment versées
- Suspension des délais de prescription en cas de procédure de dialogue/conciliation
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

Chiffres clés de l’année 2025
SMIC
Le SMIC horaire brut est de 11.88€ soit 1 801.80 € pour 151.67 heures mensualisées pour la métropole, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cela correspond à 2 059.20€ pour 169 heures mensualisées avec majoration des heures supplémentaires effectuées hebdomadairement de la 36e à la 39e heure à 25% et 2 028.31€ pour 169 heures mensualisées si majoration à 10%.
Pour Mayotte, le SMIC horaire brut passe à 8.98 € soit 1 361.97 € pour 151.67 heures mensualisées.
Minimum garanti
La valeur du minimum garanti est fixée à 4.22 €.
HCR : avantage en nature repas
La valeur de l’avantage en nature repas pour les Hotels, cafés, restaurants est de 4.22 €.
Plafond mensuel de la sécurité sociale
Le Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) s’élève à 3 925€.
- annuel : 47 100 €
- trimestriel : 11 775€
- quinzaine : 1 963€
- hebdomadaire : 906€
- journalier : 216 €
- horaire : 29 €
Attention, certaines nouveautés sociales sont encore en attente de la loi de finances 2025 et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Dans ces cas-là, les taux de 2024 sont prolongés jusqu’à l’adoption de ces deux lois.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

Barème des indemnités kilométriques
Chaque année, l’administration fiscale publie le barème des indemnités kilométriques (IK) permettant aux salariés, dirigeants et indépendants d’évaluer leurs frais de déplacement professionnel lorsqu’ils utilisent leur véhicule personnel.
Ce barème est aussi utilisé par les employeurs pour rembourser leurs salariés de manière exonérée de cotisations sociales, à condition de respecter les montants fixés par l’administration.
👉 En 2025, une nouveauté importante : les fourchettes de kilométrage des cyclomoteurs sont désormais alignées sur celles des motos, simplifiant ainsi le calcul.
Qu’est-ce que le barème kilométrique ?
Le barème kilométrique est un outil officiel servant à calculer le montant des frais de déplacement déductibles ou remboursables, en tenant compte de :
- la puissance fiscale du véhicule,
- la distance parcourue à titre professionnel dans l’année,
- les frais d’entretien, d’assurance, d’amortissement et même une partie du carburant.
Il évite de devoir conserver toutes les factures de carburant ou d’entretien : un simple relevé kilométrique suffit.
Qui peut en bénéficier ?
- Les salariés utilisant leur véhicule personnel pour des trajets professionnels (hors domicile-travail classique, sauf conditions particulières).
- Les dirigeants et indépendants imposés selon le régime réel.
- Les employeurs qui choisissent de rembourser leurs salariés via ce barème, plutôt que sur frais réels.
⚠️ Attention : ce barème ne s’applique pas aux véhicules de société mis à disposition, ni aux frais déjà pris en charge par ailleurs.
Les barèmes kilométriques 2025
Pour les voitures
Le montant de l’indemnité varie selon :
- la puissance fiscale du véhicule (de 1 à 7 CV et plus),
- la distance parcourue (jusqu’à 5 000 km, de 5 001 à 20 000 km, au-delà).
Exemple : un salarié avec une voiture 5 CV qui a parcouru 10 000 km à titre professionnel pourra se faire rembourser environ 0,60 € par km.
Pour les motos
Le barème fonctionne sur le même principe, selon la puissance et la distance parcourue.
👉 Depuis 2025, les cyclomoteurs (moins de 50 cm³) suivent désormais la même logique, ce qui simplifie les calculs.
Pour les vélos et vélos électriques
Le barème 2025 confirme l’indemnité kilométrique vélo (IKV) :
- 0,25 € par kilomètre parcouru.
Cette indemnité peut être exonérée de cotisations si elle s’inscrit dans le cadre du forfait mobilités durables.
Exemple de calcul concret
Un salarié utilisant une voiture 4 CV parcourt 7 000 km dans l’année pour ses déplacements professionnels.
- Avec le barème 2025, le remboursement est d’environ 0,55 € par km.
- Total : 3 850 € exonérés si pris en charge par l’employeur.
Pourquoi c’est important pour les employeurs ?
- Les remboursements dans la limite du barème sont exonérés de cotisations sociales.
- Le dispositif permet d’éviter un contentieux URSSAF en cas de contrôle.
- Les salariés bénéficient d’un remboursement simple et clair de leurs frais.
⚠️ En revanche, tout remboursement supérieur au barème est soumis à cotisations.
Conclusion
Le barème des indemnités kilométriques 2025 reste un outil indispensable pour la gestion des frais de déplacement professionnels.
- Simplicité pour l’employeur,
- Clarté pour le salarié,
- Sécurité fiscale et sociale pour les deux parties.
👉 Retrouvez le détail complet des barèmes 2025 (voitures, motos, cyclomoteurs et vélos) directement sur le site officiel de l’administration fiscale.
Notre fiche pratique complète
Comprenez et appliquez le barème des indemnités kilométriques : règles, trajets concernés, véhicules, montants et conditions d’exonération sur notre fiche pratique à télécharger.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)


.svg)
.svg)
.svg)
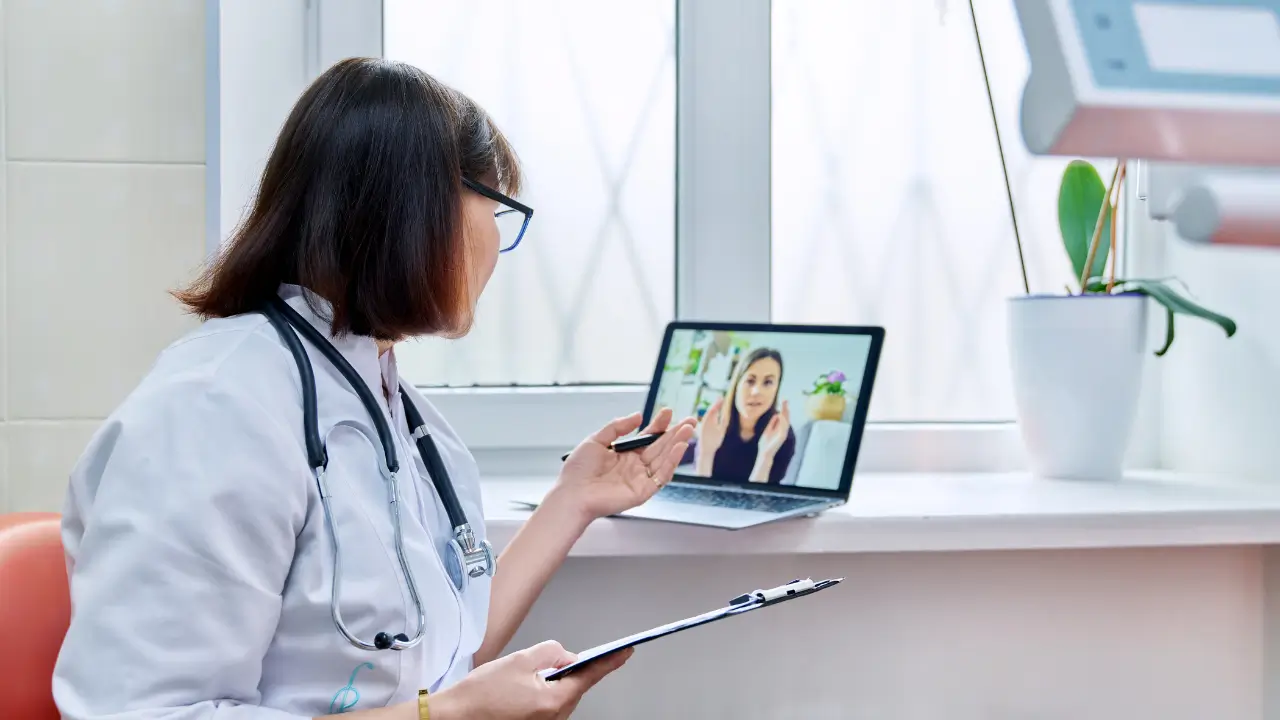










.svg)
