L'actualité paie RH, sociale et juridique des entreprises
Tenez vous informé des dernières évolutions et restez connecté !


Signalement de discrimination ou harcèlement sexuel : comment bien mener les enquêtes internes ?
Dans une décision-cadre du 5 février 2025, la Défenseure des droits a diffusé ses recommandations afin d’aider les employeurs à bien mener les enquêtes internes qui font suite à des signalements de discrimination ou de harcèlement sexuel.
Vous trouverez dans notre article un résumé de la méthodologie proposée pour conduire ces enquêtes en interne.
Différence entre signalement et alerte
En tout premier lieu, il est essentiel de distinguer le signalement de l’alerte :
- Le signalement concerne une situation vécue par une victime visant à faire cesser un comportement fautif.
- L’alerte est une démarche plus large, effectuée par un lanceur d’alerte, qui dénonce un dysfonctionnement ayant un impact au-delà de sa situation personnelle. Ainsi, un témoin d’une situation de harcèlement ou de discrimination ou une personnelle dénonçant une telle situation peuvent être qualifiés de lanceurs d’alertes.
Principales étapes de l'enquête en cas de signalement
La décision-cadre du 5 février 2025 se concentre sur le signalement et propose comme étapes majeures lors de l’enquête :
- la mise en place de dispositifs d’écoute et de recueil des signalements,
- le recueil du signalement,
- l’ouverture d’une enquête interne,
- la protection de la victime supposée et, le cas échéant.
Mise en place des dispositifs d'écoute et de recueil des signalements
Pour garantir leur efficacité, les dispositifs doivent être accessibles et communiqués à tous.
En conséquence de quoi, ces dispositifs doivent être :
- Accessibles par différents moyens de communication (email, téléphone, rendez-vous physique).
- Ouverts à toutes les personnes susceptibles de subir de tels faits : candidats, salariés, anciens salariés, intérimaires et stagiaires.
- Dissociés si possible : une cellule d’écoute distincte du dispositif de signalement.
- Gérés par des interlocuteurs formés au cadre juridique des discriminations et du harcèlement sexuel.
- Communiqués à toutes les personnes susceptibles d’être concernées (par exemple, au moyen de l’intranet et des communications internes à l’entreprise).
Recueil des signalements
Les signalements doivent être gérés avec rapidité et confidentialité.
La décision-cadre recommande notamment :
- D’accuser réception du signalement
- De demander, si le salarié en dispose, des éléments probants (témoignages, mails, etc.)
- De traiter tous les signalements même ceux anonymes
Enquête interne : règles et délais
Une enquête interne doit être lancée si les faits nécessitent des investigations supplémentaires permettant de confirmer ou d’infirmer les actes ayant fait l’objet d’un signalement.
Elle doit débuter le plus rapidement possible et dans un délai ne pouvant excéder deux mois.
Cette enquête interne doit :
- Se dérouler indépendamment de toute procédure judiciaire en cours (que cette procédure soit civile, pénale, ou administrative)
- Être lancée peu importe le délai entre les faits signalés et le signalement en lui-même
- Inclure toutes les parties : la victime, le mis en cause et les témoins pertinents
- Respecter un cadre impartial et documenter chaque étape.
L’employeur doit réagir immédiatement au premier signalement pour remplir son obligation de sécurité.
Pour rappel, l’obligation de sécurité est une obligation de résultat : l’employeur doit garantir la sécurité de ses salariés.
Protection les personnes concernées
Toujours dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur doit protéger la victime présumée mais également la personne mise en cause.
Ainsi, il faut que l’employeur tienne compte de l’état de santé physique et psychologique de toutes les personnes impliquées dans l’affaire.
De ce fait, il est recommandé de :
- Communiquer le plus rapidement possible le contact du médecin du travail à la victime supposée, à la personne mise en cause mais également aux potentiels témoins
- S’il y a eu arrêt de travail, anticiper le retour de la victime supposée (en échangeant avec elle sur les mesures lui permettant de sentir en sécurité)
- Séparer la victime et l’auteur présumé dès l’ouverture de l’enquête (l’accord-cadre prévoit par exemple la mise en télétravail, la mise à pied conservatoire de la personne mise en cause…)
- Rappeler le plus rapidement possible à la victime présumée et aux témoins par écrit l’interdiction des représailles
Conduite de l'enquête
Les bonnes pratiques pour mener une enquête impartiale incluent :
- La désignation d’au moins deux enquêteurs qualifiés, internes ou externes (par exemple un avocat)
- La formalisation d’une méthodologie d’enquête avec information du CSE et d’un suivi documentaire pour chaque enquête
- L’information de l’ouverture d’une enquête à toutes les personnes concernées
- Le rappel de l’obligation de confidentialité (rappel écrit ainsi qu’une signature d’une attestation de confidentialité par toutes les parties)
- La convocation et l’audition des parties concernées :
- De façon obligatoire : la victime présumée, les témoins pertinents qu’ils soient directs ou indirects, les témoins cités par le mis en cause (à l’appréciation des enquêteurs), les responsables hiérarchiques de la victime présumée et de la personne mise en cause et, en dernier, la personne mise en cause.
- De façon facultative : le médecin du travail, les anciens collègues, les représentants du personnel, l’inspection du travail
- La retranscription des témoignages avec validation par les personnes auditionnées via un PV d’audition
- La rédaction d’un rapport d’enquête une fois les auditions terminées (rapport qui sera conservé par l’employeur).Ce rapport expose notamment les fait reprochés et leur signalement, les mesures de protections qui ont été mises en place, les différentes étapes de l’enquête en indiquant les difficultés rencontrées (témoignage contradictoire, refus de parler…), les éléments de présomption qui ont été recueillis, les justifications de la personne mise en cause, les propositions de qualification juridique des faits dénoncés, les sanctions proposées.
La synthèse de ce rapport est par la suite communiquée à la victime présumée. - L’information aux parties concernées de la fin de l’enquête
Qualification et sanction des faits
À l’issue de l’enquête, l’employeur doit :
- Qualifier les faits selon les critères légaux
- Appliquer des sanctions proportionnées au regard de la gravité des faits
- Informer la victime des mesures prises
- Établir un bilan annuel des signalements sans données nominatives aux référents égalité/harcèlement sexuel et aux représentants du personnel
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

La participation de l’employeur aux activités sportives
Il est possible pour les employeurs de participer aux activités sportives et physiques des salariés.
Cette participation financière bénéficie d’un régime social de faveur et peut donc être exonérée de cotisations sociales dans certaines limites.
Nous vous en disons plus dans cet article !
Quelles dépenses sont couvertes par ce dispositif ?
Afin de favoriser le sport en entreprise, le financement des activités sportives des salariés par l’employeur peut être exonéré du paiement des cotisations et contributions sociales sous certaines conditions.
Ce dispositif de faveur concerne les dépenses liées :
- A la mise à disposition d’équipements sportifs à usage collectif : cela couvre ainsi la mise à disposition d’une salle de sport louée ou appartenant à l’entreprise, la souscription d’un accès collectif à une salle de sport, la mise à disposition de vestiaires et de douches, la fourniture de matériels sportifs…
- Au financement de prestations sportives pour l’ensemble des salariés : cela concerne notamment la participation financière à des cours collectifs d’activités physiques et sportives, le financement de compétitions ou d’évènements sportifs…
Quelles sont les conditions pour bénéficier de l’exonération ?
Les équipements et prestations sportifs doivent être proposés à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Aucune condition d’ancienneté ne peut être requise. Par ailleurs, il n’est pas possible de limiter ce dispositif uniquement aux salariés en CDI.
L’employeur doit informer l’ensemble des salariés :
- Des cours proposés
- Du lieu et des horaires
- Des modalités d’inscription
Dès lors que l’employeur participe financièrement à des abonnements ou des inscriptions individuels à des cours sportifs, il y aura avantage en nature et donc soumis à cotisations sociales dans son intégralité !
Cette participation de l’employeur aux activités sportives peut être cumulée avec les activités sociales et culturelles proposées éventuellement par le CSE s’il existe.
Quel montant est exonéré ?
Le montant exonéré va dépendre de la nature de l’aide de l’employeur :
- Pour la mise à disposition d’équipements sportifs à usage collectif : il n’y a pas de limite de montant.
- Pour le financement de prestations sportives : le montant de cette participation ne doit pas excéder, par année civile, 5% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (soit 196.25 € en 2025) multiplié par l’effectif ETP de l’entreprise de l’année précédente
Prenons un exemple concret :
En 2024, l’entreprise avait un effectif ETP de 59 salariés. L’employeur a décidé de financer des cours collectifs à ses salariés. Le coût pour l’année 2025 de ces cours est de 10 000€.
59 x 196.25 = 11 578.75€
Les 10 000€ engagés par l’employeur sont exonérés en totalité.
En cas de dépassement du seuil exonéré, le surplus sera soumis à cotisations sociales. Cette somme sera répartie entre les salariés bénéficiaires de cet avantage soit chaque mois, soit une fois à la fin de l’année.
Prenons un autre exemple
En 2024, l’entreprise avait un effectif ETP de 113 salariés. L’employeur a décidé de financer des cours collectifs à ses salariés. Le coût pour l’année 2025 de ces cours est de 40 000€ et 90 salariés y participent.
113 x 196.25 = 22 176.25€ donc 17 823.75€ ne sont pas exonérés.
Pour chaque salarié bénéficiaire de cet avantage, il faudra soumettre à cotisations et contributions sociales : 17 823.75 / 90 = 198.04€ par an (= 198.04€ en décembre ou 16.50€ tous les mois à soumettre à cotisations sociales).
Et si c’est le CSE qui prend en charge les activités sportives ?
Le sport figure parmi les activités sociales et culturelles proposées par le comité social et économique.
Selon une tolérance issue de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, et sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les prestations en nature ou en espèces fournies par le CSE aux salariés lorsqu’elles sont directement liées aux activités sociales et culturelles du comité, ne sont pas soumises à cotisations sociales.
Cela inclut notamment les avantages qui encouragent, sans discrimination, les activités extra-professionnelles, sociales ou culturelles (détente, sport ou loisirs) des salariés et de leurs familles.
Dans ce cadre, l’ACOSS reconnaît, entre autres, les réductions tarifaires accordées pour la pratique d’activités sportives.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)
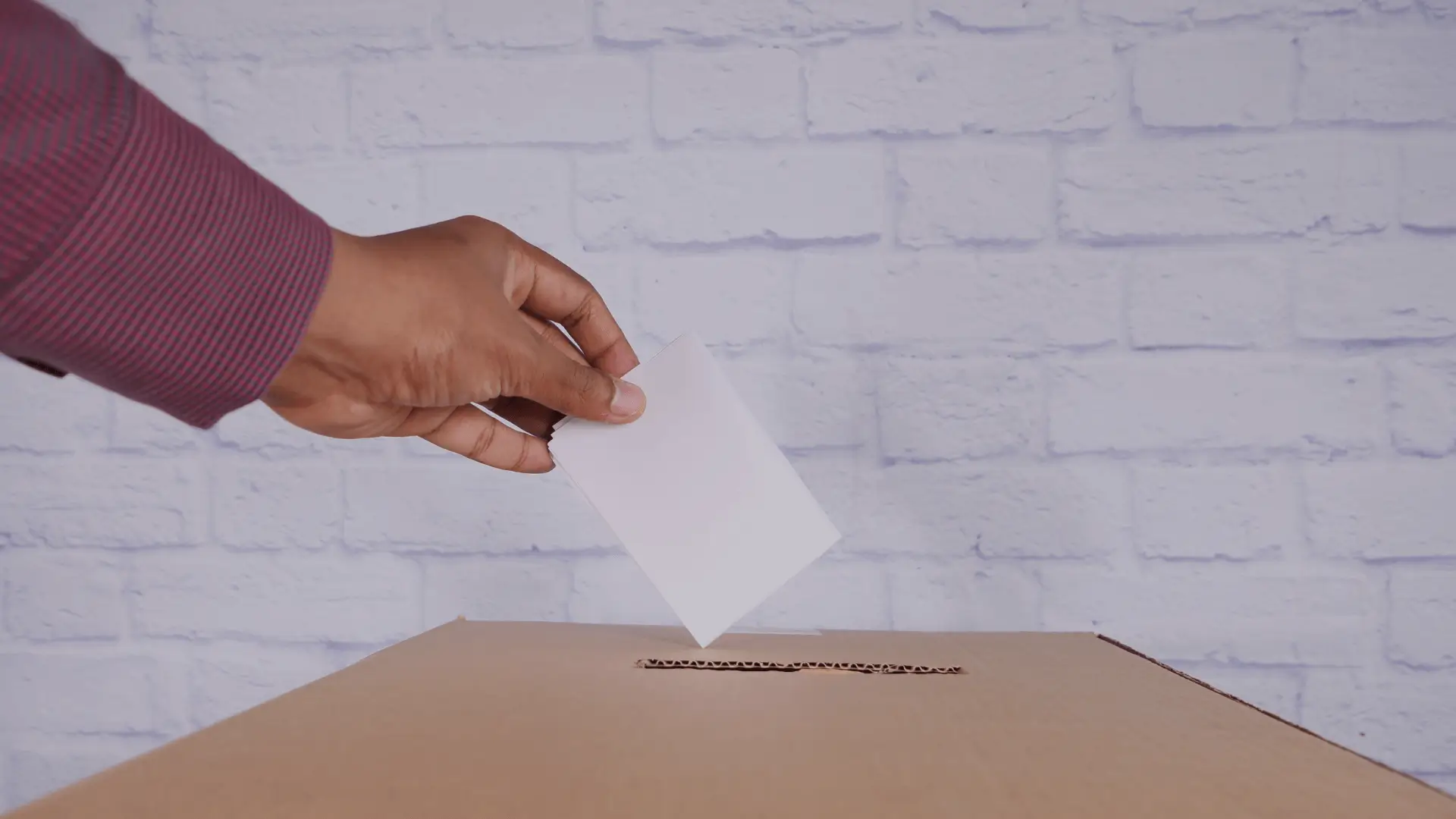
Élections CSE : la Cour de cassation limite les protocoles préélectoraux sur l’alternance H/F
Le code du travail impose que les listes de candidats aux élections du comité social et économique (CSE) respectent une stricte alternance entre hommes et femmes. Cependant, cette obligation n’établit pas de règles précises concernant la position ou l’ordre de cette alternance. La Cour de cassation a récemment statué sur cette question en annulant une disposition incluse dans un protocole d’accord préélectoral (PAP) qui imposait un ordre spécifique de candidats.
Une règle d’ordre public absolu pour la parité hommes-femmes
Le code du travail prévoit que les listes de candidats, pour chaque collège électoral et pour les titulaires comme les suppléants, doivent refléter la proportion d’hommes et de femmes inscrits sur la liste électorale. Ces listes doivent également respecter une alternance stricte entre candidats des deux sexes jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes (c. trav. art. L. 2314-29 et L. 2314-30).
Cette règle, considérée comme d’ordre public absolu, garantit la parité dans la représentation syndicale. Cependant, aucune disposition légale n’exige que cette alternance commence par un candidat d’un sexe particulier ou suive un ordre spécifique.
Le cas d’un protocole préélectoral contesté
Dans une affaire récente, un protocole préélectoral fixait des ordres précis d’alternance H/F pour les différents collèges :
- Collège 1 : cinq hommes et une femme (H-F-H-H-H-H)
- Collège 2 : trois hommes et une femme (H-F-H-H)
- Collège 3 : deux hommes et une femme (H-F-H).
Un syndicat, en désaccord avec cette disposition, a présenté une liste pour le 3ᵉ collège avec un ordre différent (F-H-H). Le tribunal judiciaire avait donné raison à l’employeur, estimant que le syndicat n’avait pas respecté le protocole préélectoral.
Le cas d’un protocole préélectoral contesté
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a rappelé deux points fondamentaux :
- La règle d’alternance H/F est impérative, mais n’impose pas de position ni d’ordre spécifique.
- Un protocole préélectoral ne peut inclure de dispositions contraires au code du travail ou imposer des critères non prévus par la loi.
En conséquence, la Cour a annulé le jugement du tribunal judiciaire et renvoyé l’affaire devant une autre juridiction.
Ce qu’il faut retenir
Les protocoles préélectoraux doivent respecter les dispositions légales en matière de parité, mais ne peuvent imposer d’ordre spécifique pour l’alternance des candidats. Cette décision rappelle l’importance de garantir une représentation équilibrée tout en respectant les prérogatives des syndicats dans l’établissement de leurs listes.
En savoir plus
- Consultez la décision complète de la Cour de Cassation
- Téléchargez notre fiche pratique dédiée
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

Licenciement économique : la moindre erreur de reclassement peut coûter cher
Licenciement économique : quand l’absence de critères de départage invalide la procédure
Dans une décision récente du 8 janvier 2025, la Cour de cassation a annulé neuf licenciements économiques en raison d’une défaillance dans les offres de reclassement transmises aux salariés. Le motif ? L’absence de critères de départage en cas de candidatures multiples sur un même poste, une exigence pourtant imposée par le code du travail.
Les bases légales du licenciement économique
Le licenciement économique ne peut être envisagé qu’en ultime recours, après que l’employeur a :
- exploré toutes les solutions de formation et d’adaptation des salariés concernés ;
- effectué une recherche de reclassement pour les postes disponibles dans l’entreprise ou les autres entités du groupe, situées sur le territoire national (c. trav. art. L. 1233-4).
Les postes proposés doivent relever de la même catégorie que le poste occupé ou être équivalents avec une rémunération similaire. En cas d’impossibilité, l’employeur peut proposer un emploi de catégorie inférieure, mais uniquement avec l’accord explicite du salarié.
Une obligation précise de l’employeur
Conformément au code du travail (c. trav. art. D. 1233-2-1), les offres de reclassement doivent inclure :
- tous les postes disponibles sur le territoire national dans l’entreprise et les entités du groupe ;
- les critères de départage pour les candidatures multiples sur un poste ;
- un délai minimum de réponse pour les salariés (15 jours francs, ou 4 jours en cas de redressement ou liquidation judiciaire).
L’employeur peut communiquer ces offres de manière personnalisée ou via une liste globale accessible à tous les salariés concernés.
Un manquement aux obligations de reclassement
Dans l’affaire jugée, l’employeur avait fourni une liste des postes disponibles à neuf salariés menacés de licenciement économique. Cependant, cette liste ne précisait pas les critères de départage en cas de candidatures multiples sur un même poste.
Malgré leur adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), les salariés ont contesté la procédure devant les tribunaux. La cour d’appel a considéré que cette omission constituait un manquement à l’obligation de recherche loyale de reclassement. La Cour de cassation a confirmé cette analyse, estimant que ces licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Les conséquences pour les employeurs
Cette jurisprudence rappelle l’importance de :
- respecter scrupuleusement les obligations légales en matière de reclassement ;
- fournir des offres de reclassement complètes, incluant tous les postes disponibles et les critères de départage ;
- garantir une procédure loyale et transparente pour éviter tout contentieux.
Ce jugement illustre l’exigence de rigueur imposée aux employeurs dans les procédures de licenciement économique. Une communication insuffisante peut avoir de lourdes conséquences juridiques et financières. Paie & RH Solutions vous accompagne pour éviter ces écueils et garantir une conformité parfaite dans vos démarches sociales.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

Prolongation des Titres-Restaurant pour tout produit alimentaire Jusqu’en 2026 : Ce Qu’il Faut Savoir
Le 14 janvier 2025, une avancée majeure a été confirmée par le Sénat : l’utilisation dérogatoire des titres-restaurant pour l’achat de tout produit alimentaire est prolongée jusqu’au 31 décembre 2026. Cette mesure, attendue par les salariés et les employeurs, élargit le champ d’application de ces titres en réponse aux besoins croissants liés à l’inflation.
Retour sur une mesure pour le pouvoir d’achat
Adoptée initialement dans le cadre de la loi Pouvoir d’achat du 16 août 2022, cette dérogation permet aux salariés d’utiliser leurs titres-restaurant pour acquitter en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire. Cette mesure inclut des denrées telles que le riz, les pâtes, la viande ou le poisson non transformés, tout en excluant l’alcool, les confiseries, les produits infantiles et les aliments pour animaux.
La mesure, mise en place pour soutenir le pouvoir d’achat face à l’inflation, devait initialement prendre fin au 31 décembre 2023. Une première extension l’avait prolongée jusqu’à la fin de l’année 2024.
Janvier 2025 : une période d’incertitude
Au début de l’année 2025, l’absence de cadre législatif clair avait limité l’utilisation des titres-restaurant à des produits directement consommables, ainsi qu’aux fruits et légumes. Cette restriction temporaire avait suscité des interrogations chez les salariés et employeurs.
Une décision définitive pour deux années supplémentaires
Dès le 4 novembre 2024, une proposition de loi avait été déposée à l’Assemblée nationale pour étendre cette mesure. Adoptée en première lecture avec un amendement portant sa durée jusqu’au 31 décembre 2026, le texte a été voté par le Sénat le 14 janvier 2025.
Cette adoption définitive permet aux salariés de continuer à bénéficier d’un accès élargi à des produits alimentaires variés tout en offrant aux entreprises une flexibilité accrue dans la gestion des avantages sociaux.
Conséquences pour les employeurs et salariés
La prolongation de cette mesure :
- Renforce le pouvoir d’achat des salariés face à une inflation toujours présente.
- Simplifie la gestion des avantages sociaux pour les employeurs en maintenant un dispositif connu et apprécié.
- Favorise la consommation responsable, en élargissant l’accès à des produits essentiels.
Récapitulatif des exclusions
Il est important de rappeler que certains produits restent exclus de cette dérogation, notamment :
- L’alcool
- Les confiseries
- Les produits infantiles
- Les aliments pour animaux
En savoir plus
Pour consulter le texte adopté par le Sénat, rendez-vous sur le site officiel du Sénat
Pour Comprendre le fonctionnement et les implications des titres-restaurants pour les employeurs et les salariés, RDV sur notre fiche pratique dédiée.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)


.svg)
.svg)
.svg)
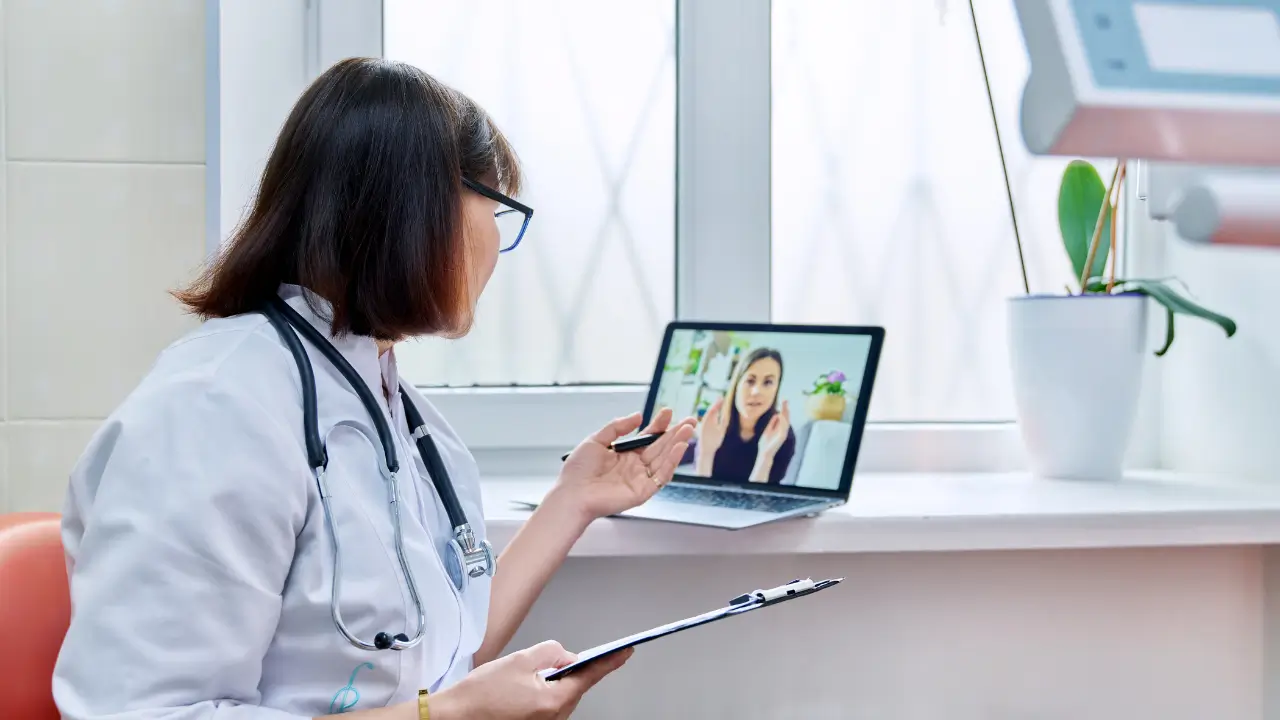










.svg)
