L'actualité paie RH, sociale et juridique des entreprises
Tenez vous informé des dernières évolutions et restez connecté !


Guide pour les entretiens et bilans professionnels
Les entretiens et bilans professionnels sont des outils essentiels pour la gestion des ressources humaines. Ils permettent d’évaluer les compétences, les performances et les aspirations des employés, tout en offrant une opportunité de dialogue entre le salarié et l’employeur. Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes de ces entretiens, leur importance, les thèmes à aborder obligatoirement et comment les mener efficacement.
Nous vous rappellerons également vos obligations et nous ferons des focus sur les changements amenés par la loi Avenir Professionnel !
A noter qu’un entretien d’évaluation est toujours une faculté ouverte à l’employeur.
Attention aux sanctions !
Depuis le 01/10/2021, la loi prévoit 3000 € d’abondement sur le CPF dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si le salarié n’a pas bénéficié les 6 dernières années :
- des entretiens professionnels,
- d’au moins une action de formation non obligatoire.
L’Entretien Professionnel : Un Outil Clé pour le Développement des Carrières
L’entretien professionnel est un rendez-vous incontournable pour les salariés et les employeurs. Il permet principalement de faire le point sur les perspectives d’évolution professionnelle et des besoins en formation. Par ailleurs, le salarié devra être informé dès son embauche qu’il bénéficiera d’un entretien professionnel.
Un entretien professionnel obligatoire tous les 2 ans
L’entretien professionnel est obligatoire tous les deux ans pour tous les salariés. On raisonne de date à date.
Exemple : Si un entretien s’est déroulé le 1er juillet 2024, le prochain entretien devra être organisé le 1er juillet 2026.
Attention un accord collectif peut prévoir une périodicité différente pour la tenue des entretiens professionnels.
Comme mentionné ci-dessus, l’entretien se concentre sur les perspectives d’évolution professionnelle des salariés tout en les informant sur les formations auxquelles ils ont droit.
Thèmes à aborder lors de l'entretien professionnel
- Les Perspectives d’Évolution Professionnelle du Salarié : ici, on parle essentiellement d’évolution en termes de qualifications et d’emploi des salariés.
- Les Formations pouvant contribuer à ces perspectives d’évolution : cela peut inclure des formations internes ou externes, des ateliers, ou des séminaires.
- La Possibilité d’Effectuer une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) : elle permet aux salariés de faire reconnaître officiellement leurs compétences acquises par l’expérience.
- Le Bilan du Parcours du Salarié depuis son Entrée dans l’Entreprise
- La Présentation du Conseil en Évolution Professionnelle (CEP) : il s’agit d’un dispositif gratuit d’accompagnement personnalisé pour aider les salariés à faire le point sur leur situation professionnelle et à élaborer un projet d’évolution.
- L’Activation du CPF (Compte Personnel de Formation) et ses Modalités d’Abondement : le CPF permet aux salariés de cumuler des droits à la formation tout au long de leur carrière.
Quels salariés sont concernés ?
Tous les salariés de l’entreprise, dès lors qu’ils ont au moins 2 ans d’ancienneté (CDI, CDD, contrats aidés, à temps partiel ou à temps plein).
De plus, un salarié ayant eu une longue absence doit systématiquement avoir un entretien à son retour :
- congé maternité, congé parental, congé d’adoption
- congé de proche aidant, congé sabbatique, période de mobilité volontaire sécurisée
- arrêt maladie ou accident de plus de 6 mois
A quelle date l'entretien de reprise doit-il avoir lieu ?
Rien n’est indiqué dans les textes mais le plus rapidement possible sachant que cet entretien peut avoir lieu avant la reprise du salarié lorsqu’il en fait la demande.
Que faire en cas d'absence du salarié à l'entretien ?
Il faut distinguer deux situations :
- Si un salarié prévoit une absence à la date de l’entretien professionnel, il est possible de reporter l’entretien à une autre date, tant que celle-ci n’est pas trop éloignée de la date anniversaire, dans la mesure du possible.
- En cas d’absence imprévisible, le code du travail n’oblige pas explicitement l’employeur à fixer une autre date pour l’entretien, et les juges ne l’exigent pas non plus pour le moment. Cependant, il est conseillé de le faire par prudence, étant donné l’importance de l’entretien professionnel et les sanctions encourues en cas d’absence. Il convient de faire la distinction entre l’absence involontaire du salarié (oubli, arrêt maladie…) et un refus délibéré de sa part. Dans ce dernier cas, le refus du salarié pourrait être considéré comme une insubordination et entraîner des sanctions. Dans cette situation, il est préférable pour l’employeur de conserver la preuve de la convocation à l’entretien, des relances éventuelles et, si possible, du refus du salarié.
Quel document à l'issue de l'entretien ?
A l’issue de l’entretien, il convient de remettre au salarié un compte-rendu récapitulant ce qu’il s’est dit lors de l’entretien.
Par ailleurs, tous les 6 ans : l’entretien doit être complété d’un « bilan professionnel ».
Le Bilan Professionnel : Un État des Lieux Essentiel pour les Salariés
Le bilan professionnel est un outil clé pour évaluer le parcours professionnel des salariés. Créé par la loi de 2014 et applicable tous les six ans, il permet de faire un état des lieux des compétences et des évolutions de carrière.
En Quoi Consiste le Bilan Professionnel ?
Le bilan professionnel est un “état des lieux” récapitulant le parcours professionnel du salarié. Il a lieu pour la première fois en 2020 et doit permettre de vérifier trois points clés sur les six années écoulées :
- Le salarié a-t-il suivi au moins une action de formation ?
- A-t-il acquis une certification (par formation ou VAE) ?
- A-t-il bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle ?
Il est conseillé de rédiger un compte-rendu de cet échange avec le salarié et de lui en remettre une copie.
Il est vivement conseillé de rédiger un compte-rendu de cet échange avec le salarié, et de lui en remettre une copie.
Une Nouvelle Obligation avec une Sanction Prévue pour les Entreprises de 50 Salariés et Plus
La loi Avenir Professionnel a modifié les obligations pour les entreprises. Elles doivent notamment vérifier :
- Les trois points clés ci-dessus (formation, progression salariale ou évolution de qualification).
- Si les deux entretiens professionnels précédents (tous les deux ans) ont bien eu lieu.
Sanctions en Cas de Non-Respect
Pour les entreprises d’au moins 50 salariés, une sanction est prévue si le salarié n’a pas bénéficié des entretiens professionnels et s’il n’a pas suivi au moins une formation “non obligatoire” au cours des six dernières années. Dans ce cas, l’entreprise devra verser sur le CPF du salarié un abondement supplémentaire pouvant aller jusqu’à 3 000 €. Cet abondement devra être versé au plus tard le dernier jour du trimestre civil qui suit la date de l’entretien sexennal.
Exemple
Si lors de l’entretien sexennal du 3 mars 2024 un manquement à ces obligations est constaté, l’employeur aura jusqu’au 30 juin 2024 pour transmettre les informations et verser l’abondement correctif.
Inscription des Heures de DIF sur le CPF
Les heures acquises au titre du DIF peuvent être utilisées dans le cadre du CPF, sans limite de temps, sous réserve que le titulaire du compte les ait inscrites sur son compte avant le 30 juin 2021. À défaut d’inscription, le solde d’heures de DIF a été perdu.
Schéma récapitulatif

Les Entretiens d’Évaluation : Un Outil de Gestion des Performances
L’entretien d’évaluation offre un moment d’échange avec le salarié pour faire le bilan de la période passée, y compris les missions et les tâches accomplies par rapport aux objectifs fixés, les succès et les difficultés rencontrés, ainsi que les points forts et les axes d’amélioration.
Entretiens d’Évaluation : Une Simple Faculté
Le fait de prévoir des entretiens d’évaluation dans une entreprise n’est pas une obligation, il ne s’agit que d’une simple faculté, sauf dispositions conventionnelles contraires.
Habituellement annuel, l’entretien d’évaluation peut également se dérouler à d’autres intervalles définis soit en interne soit par accord collectif.
Des points d’étapes peuvent également être instaurés pour ajuster les objectifs à atteindre.
Objectifs de l’Entretien d’Évaluation
L’entretien d’évaluation permet principalement sur la période considérée de :
- Faire le bilan des missions et des tâches accomplies notamment par rapport aux objectifs fixés précédemment
- Identifier les succès et les difficultés rencontrés par le salarié
- Déterminer les points forts et les axes d’amélioration
Les entretiens d’évaluation permettent ainsi à l’employeur de prendre des décisions concernant l’évolution professionnelle de chaque salarié. Cela peut inclure des promotions, des augmentations salariales, ou des changements de poste par exemple.
Consultation du CSE et Information des Salariés
Si l’employeur souhaite mettre en place ces entretiens, il est nécessaire de consulter le Comité Social et Économique (CSE) au préalable, s’il existe, et d’informer les salariés sur les modalités de ces entretiens.
Les entretiens d’évaluation, bien que facultatifs, sont des outils précieux pour la gestion des performances et le développement des carrières. En les utilisant de manière stratégique, les entreprises peuvent non seulement améliorer la performance de leurs salariés, mais aussi renforcer leur engagement et leur satisfaction.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

Comment gérer une interruption collective de travail liée à des pannes informatiques, de matériel ou des coupures d’électricité ?
Des problèmes informatiques, des pannes de matériel, des coupures électriques ou de réseau internet peuvent intervenir pour différentes raisons :
- intempéries
- sinistres
- cybercriminalité
- incidents sur le réseau informatique
- problèmes chez les fournisseurs d’internet…
Ces différents scénarios peuvent perturber grandement le travail des salariés voire suspendre totalement et collectivement l’activité de la société.
Comment l’employeur peut-il réagir face à de telles interruptions collectives de travail dans ces hypothèses ?
Aménager le poste de travail des salariés
L’employeur peut affecter, si cela est possible, les salariés à des tâches ne nécessitant pas l’utilisation des équipements impactés par la panne.
Il est à noter que certaines conventions collectives nationales imposent de privilégier cette solution à d’autres, notamment par rapport à la récupération.
Attention toutefois, en cas de panne d’électricité, il n’est pas possible pour l’employeur de faire travailler ses salariés sans électricité, chauffage ou lumière. Une telle situation contreviendrait à son obligation de sécurité. En pareil cas, les salariés pourraient faire valoir leur droit de retrait.
Aménager les horaires ou la durée de travail des salariés
L’employeur peut proposer différentes solutions à ses salariés afin d’aménager leur horaire de travail sur la même journée, sur la semaine voire plus. Il peut ainsi :
Modifier les horaires des salariés sur la journée
Afin de libérer la plage horaire impactée en cas d’incident prévisible (par exemple, une coupure d’électricité qui serait annoncée) ou aménager les horaires des salariés sur la semaine.
Cette modification s’imposera aux salariés étant donné qu’il ne s’agit que d’une modification des conditions de travail, sauf si les horaires ont été contractualisés ou si la modification bouleverse la vie privée et familiale du salarié. Dans une telle situation, l’accord des salariés devra être recueilli pour pouvoir modifier les horaires mentionnés dans le contrat de travail.
Demander aux salariés de récupérer les heures perdues
Via le dispositif de récupération en cas de cause de force majeure ou de cause accidentelle. Dans cette situation, l’employeur a 12 mois suivant ou précédant la perte des heures pour les faire récupérer.
Pour recourir à ce dispositif, l’employeur doit informer l’inspecteur du travail, consulter le CSE s’il existe et afficher l’horaire modifié. Il faudra également être attentifs aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi qu’aux durées de repos.
En l’absence d’accord collectif sur le sujet, la récupération est limitée à :
- 1 heure de plus par jour
- 8 heures de plus par semaine
En cas de récupération, les heures qui sont à effectuer en vertu de ce dispositif ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
La récupération s’impose en principe aux salariés sauf disposition conventionnelle plus favorable. Attention donc à consulter votre CCN sur le sujet car certaines peuvent effectivement prévoir qu’en cas d’interruption collective de travail, l’employeur doit chercher des possibilités d’emploi dans l’entreprise avant d’avoir recours à la récupération. A défaut, les salariés pourront refuser la récupération et ne pourront faire l’objet d’une retenue sur salaire.
Permettre aux salariés de poser un jour de congés payés, de RTT ou de repos compensateur
Si les congés ne peuvent être imposés par l’employeur sauf en cas de fermeture annuelle de la société, les jours de RTT, de repos ou compensateurs peuvent être imposés si les accords collectifs les mettant en place le prévoit.
Mettre les salariés en absence autorisée rémunérée
Aménager le lieu de travail des salariés
Si cela est possible au regard du poste du salarié et de la nature de l’incident, il est également possible d’aménager le lieu de travail notamment via le télétravail. Mais il est également possible d’envisager d’autres possibilités :
- Proposer aux salariés de manière exceptionnelle de télétravailler si les problèmes touchent les locaux de la société et si le domicile du salarié n’est pas impacté par la panne. A noter que le code du travail prévoit que l’employeur peut imposer le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles.
- Inversement, si c’est le domicile du salarié qui est impacté alors qu’il est en télétravail, l’employeur pourra imposer au salarié de revenir sur site.
- Si l’entreprise comporte plusieurs établissements dans un même secteur géographique et qu’un seul établissement est touché par l’incident, il sera également possible pour l’employeur de demander aux salariés de travailler exceptionnellement sur l’établissement non impacté.
Recours à l’activité partielle
Si aucune des solutions mentionnées précédemment n’est applicable à la société, l’employeur pourra toujours faire une demande d’activité partielle.
En effet, le problème étant collectif, il est possible pour l’employeur de faire une demande d’activité partielle fondée, selon les situations, sur le motif de « Sinistres ou intempéries de caractère exceptionnel » ou bien « Toute circonstance de caractère exceptionnel ».
Pour rappel, l’activité partielle est un dispositif collectif permettant à l’employeur de diminuer la durée de travail du salarié voire de fermer temporairement tout ou partie de l’entreprise. Il indemnisera en partie le salarié et bénéficiera, en cas d’accord de l’administration, d’une allocation d’activité partielle.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

Bachelor Chargé des Ressources Humaines
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de notre nouveau programme au sein de la Paie & RH Académie : le Bachelor Chargé des Ressources Humaines en alternance ! Ce programme est désormais accessible dans nos tout nouveaux locaux situés à Helioparc, Pau.
Pourquoi choisir ce Bachelor ?
Le secteur des ressources humaines est en constante évolution et requiert des professionnels qualifiés capables de gérer les talents, d’accompagner les transformations organisationnelles et de répondre aux enjeux stratégiques des entreprises. Notre Bachelor est conçu pour former les futurs professionnels RH, alliant théorie et pratique grâce au format de l’alternance.
Une formation RH complète et immersive
Le programme du Bachelor Chargé des Ressources Humaines couvre une large gamme de compétences indispensables pour exceller dans ce domaine :
- Gestion administrative du personnel : Apprenez à gérer les dossiers du personnel, de l’embauche à la sortie de l’entreprise.
- Recrutement et intégration : Maîtrisez les techniques de sourcing, de sélection et d’intégration des nouveaux collaborateurs.
- Formation et développement des compétences : Découvrez les stratégies pour accompagner et faire évoluer les talents au sein de l’organisation.
- Relations sociales et dialogue social : Développez vos compétences en matière de négociation et de gestion des relations avec les partenaires sociaux.
- Gestion de la paie et des avantages sociaux : Acquérez une expertise technique dans le calcul et la gestion de la paie.
Un cadre d'apprentissage exceptionnel
Nos nouveaux locaux à Helioparc, en plein centre de Pau, offrent un environnement moderne et stimulant, propice à l’apprentissage et à l’épanouissement personnel et professionnel. Les étudiants bénéficient d’infrastructures de pointe et d’un accès facile aux ressources pédagogiques nécessaires.
Les avantages de l'alternance avec la Paie & RH Académie
L’alternance constitue une véritable passerelle vers l’emploi. En intégrant notre Bachelor, vous aurez l’opportunité de :
- Mettre en pratique vos acquis théoriques dans un contexte professionnel réel.
- Développer des compétences directement applicables en entreprise.
- Accumuler une expérience précieuse et construire un réseau professionnel solide.
- Bénéficier d’une rémunération tout en poursuivant vos études.
L'importance de notre CFA d'entreprise
La création d’un Centre de Formation des Apprentis (CFA) au sein de Paie & RH Solutions est une étape cruciale pour renforcer notre engagement envers la formation professionnelle. Ce CFA d’entreprise permet de proposer des cursus en alternance adaptés aux besoins spécifiques de nos partenaires et de nos propres activités. En formant nos futurs collaborateurs dans un environnement qui reflète les réalités du marché du travail, nous assurons une adéquation parfaite entre les compétences enseignées et les exigences professionnelles. Cela favorise l’intégration rapide des diplômés dans le monde du travail, tout en répondant aux besoins croissants de compétences spécialisées dans le domaine des ressources humaines.
Entreprises, rencontrez nos talents
Vous êtes une entreprise à la recherche de nouveaux talents en ressources humaines ? La Paie & RH Académie vous propose une sélection de profils admissibles validés par notre processus d’admission. En collaborant avec notre académie, vous bénéficiez de l’accès à une pool de candidats motivés et déjà familiarisés avec les exigences du monde professionnel. Nos étudiants, grâce à leur formation en alternance, sont prêts à s’intégrer rapidement et efficacement au sein de votre organisation, apportant des compétences actualisées et une forte capacité d’adaptation.
Rejoignez-nous !
Les inscriptions pour le Bachelor Chargé des Ressources Humaines en alternance sont ouvertes. N’attendez plus pour rejoindre la Paie & RH Académie et donner un coup d’accélérateur à votre carrière !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet ou contactez notre service des admissions.
- Vous êtes un étudiant : Inscrivez vous ici !
- Vous êtes une entreprise : Recrutez un alternants !
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

Sanctions Disciplinaires en Entreprise : Guide Complet et Pratique
Les sanctions disciplinaires au sein d’une entreprise sont un outil essentiel pour assurer la discipline et le bon fonctionnement de l’organisation. Cependant, leur application nécessite une compréhension approfondie des règles et des procédures légales afin d’éviter tout litige potentiel. Dans cet article, nous vous partageons des cas concrets et nous vous apportons des réponses claires ainsi que des outils pratiques pour gérer efficacement les sanctions disciplinaires au sein de votre entreprise.
Nous allons explorerons en détail chaque aspect clé des sanctions disciplinaires, du règlement intérieur à la procédure de sanction, en passant par les dispositifs de surveillance et les types de sanctions appropriés.
Le Règlement Intérieur : Fondation de la Discipline au Travail
Un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus.
C’est le socle sur lequel repose la régulation des comportements attendus au sein de l’entreprise mais il permet aussi de légitimer les sanctions disciplinaires en cas de non-respect. Sa rédaction doit respecter scrupuleusement les exigences légales pour être valide et applicable. On vous explique tout.
Le règlement intérieur fixe :
- Les règles de conduite dans l’entreprise en matière de santé et de sécurité
- Les règles concernant la discipline notamment la nature et l’échelle des sanctions.
Les restrictions que le règlement impose aux salariés doivent être justifiées par la nature de l’activité à réaliser et proportionnées au but recherché.
Les dispositions du règlement intérieur doivent être conformes aux dispositions des lois, règlements et conventions collectives applicables.
La procédure de dépôt à respecter
- Consultation des représentants du personnel
- Communication en 2 exemplaires du règlement intérieur accompagné de l’avis du CSE à l’inspecteur du travail (deux mois pour validation)
- Dépôt au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement
- Le règlement intérieur est porté, par tout moyen (affichage, intranet) à la connaissance des personnes dans les lieux de travail.
Le Règlement Intérieur rentre en application 1 mois après l’accomplissement des formalités à tous les salariés et stagiaires de la société.
Les dispositifs de surveillance, la prescription et le respect des droits des salariés
Les dispositifs de surveillance
La surveillance des salariés peut être nécessaire pour assurer la sécurité, la productivité et la conformité réglementaire. Cependant, elle doit être menée de manière respectueuse des droits fondamentaux des salariés.
L’employeur peut recourir à des dispositifs de surveillance pour collecter des preuves à des fins disciplinaires comme la vidéosurveillance ou la géolocalisation.
Ces dispositifs de surveillance doivent être proportionnés au but légitime recherché et doivent faire l’objet d’une information au préalable.
Il convient de respecter la procédure suivante :
- Consultation des représentants du personnel
- Information individuelle du salarié
L’information doit indiquer que les données collectées par le dispositif de surveillance peuvent être utilisées à des fins disciplinaires.
Compte tenu du RGPD, les données collectées ne peuvent être conservées de manière indéfinie.
La prescription
La prescription des faits fautifs est de 2 mois à compter du jour où l’employeur a connaissance de ces faits.
Ce délai peut être prolongé si l’employeur est dans l’obligation de mener une enquête afin de déterminer avec précision l’ensemble des faits fautifs reprochés au salarié.
Aucune sanction antérieure de plus de 3 ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
Les Différents Types de Sanctions : Adaptation à Chaque Situation
Les sanctions disciplinaires doivent être proportionnées à la gravité de la faute commise. Voici les différents types de sanctions :
- Le blâme.
- L’avertissement : document écrit de reproches au salarié.
- La mise à pied à titre disciplinaire : période non travaillée et non rémunérée de 15 jours maximum.
- La mutation : changement de lieu de travail.
- La rétrogradation : changement de classification avec diminution de la rémunération.
- Le licenciement pour faute simple : versement d’une indemnité de licenciement.
- Le licenciement pour faute grave : maintien au sein de la société impossible.
- Le licenciement pour faute lourde : intention de nuire à l’employeur.
L’avertissement, la mise à pied à titre disciplinaire et le licenciement sont les plus utilisées
Deux principes à respecter :
- Aucun fait fautif ne peut être sanctionné deux fois
- Les sanctions pécuniaires sont interdites
Deux rappels :
- Il est interdit de licencier un salarié pour certains motifs (exercice du droit de grève, motif discriminatoire)
- Il est interdit de licencier une salariée en congé maternité (protection absolue)
Pour plus de détail, nous vous invitons à consulter notre fiche pratique sur la « Rupture de Contrat et les Délais à Respecter« .
Principe de Proportionnalité : Clé de la Justice Disciplinaire
Pour attribuer une sanction disciplinaire adaptée, il faut respecter le principe de proportionnalité de la sanction.
Eléments factuels à prendre en considération pour respecter le principe de proportionnalité de la sanction :
- L’ancienneté
- Les antécédents disciplinaires sur les 3 dernières années
- Le respect de l’échelle de sanction prévue dans le Règlement intérieur ou la Convention collective applicable
- Les circonstances aggravantes de la faute commise :
- répétition
- gravité
- public
- dissimulation
- Les circonstances atténuantes de la faute commise :
- information de l’employeur ou du supérieur hiérarchique
- reconnaissance des faits
- aveux
- excuses et regrets
- traitement des conséquences de la faute
Respecter le principe de proportionnalité est essentiel pour éviter tout risque de contestation ou de litige.
La procédure de sanction disciplinaire
La procédure de sanction disciplinaire doit suivre un processus précis pour être valide. Voici les étapes clés :
- Découverte des faits fautifs
Respecter un délai de 2 mois maximum entre la découverte des faits et le lancement de la procédure (par convocation).
- Envoi de la convocation à l’entretien
Respecter un délai de 5 jours ouvrables minimum entre la première présentation de la lettre au salarié et le jour de l’entretien.
- Tenu de l’entretien au préalable
Délai de 2 jours ouvrables minimum et 1 mois maximum entre l’entretien et le jour d’envoi de la notification
- Notification de la sanction
Nos conseils pour une procédure sécurisée :
Il est impératif de vérifier que le salarié concerné par la procédure n’ait pas le statut de salarié protégé. Pour rappel les salariés protégés sont principalement :
- les représentants du personnel
- les salariées en situation de maternité
En cas de licenciement, il est primordial de vérifier que le salarié ne dispose pas d’une clause de non-concurrence.
Si l’employeur souhaite lever cette clause, il peut le faire jusqu’à la notification du licenciement, pas au-delà.
La procédure de sanction disciplinaire pour un salarié protégé
La procédure de sanction disciplinaire pour un salarié protégé (principalement les représentants du personnel et les salariées en situation de maternité) doit suivre un processus précis pour être valide. Voici les étapes clés :
- Découverte des faits fautifs
Respecter un délai de 2 mois maximum entre la découverte des faits et le lancement de la procédure (par convocation).
- Envoi de la convocation à l’entretien
Respecter un délai de 5 jours ouvrables minimum entre la première présentation de la lettre au salarié et le jour de l’entretien.
Le demande d’autorisation se fait dans les jours suivant la réunion avec le CSE.
L’inspecteur dispose d’un délai de 2 mois afin de se prononcer en faveur ou non du licenciement.
En l’absence de réponse, pas de licenciement.
- Tenu de l’entretien au préalable
Suite à l’entretien préalable, l’employeur doit réunir le CSE afin d’avoir leur avis, à titre consultatif, sur le licenciement.
- Réunion avec le CSE
Le demande d’autorisation se fait dans les jours suivant la réunion avec le CSE.
- Autorisation de l’Inspection du Travail
L’inspecteur dispose d’un délai de 2 mois afin de se prononcer en faveur ou non du licenciement. En l’absence de réponse, pas de licenciement.
Suite à l’autorisation, l’employeur envoi le courrier de notification par lettre recommandée.
- Notification du licenciement
Le salarié protégé dispose alors d’un délai de 2 mois pour contester son licenciement.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

Nouveauté en cas de refus d’un CDI après un CDD ou un intérim
La loi Marché du travail du 21 décembre 2022 prévoyait une mesure consistant à priver de chômage les salariés embauchés en CDD ou en intérim et ayant décliné à deux reprises une offre de Contrat à Durée Indéterminée (CDI). Après un décret d’application, la mesure est devenue applicable à compter du 1er janvier 2024.
On vous en dit plus !
Le principe de ce nouveau dispositif
Le nouveau dispositif consiste à priver d’allocations chômage, sous conditions, les salariés embauchés en CDD ou en contrat d’intérim et qui refuseraient deux fois une proposition de CDI sur le même emploi ou un emploi similaire.
Les propositions de CDI visées par ce dispositif sont celles faites :
Par l’employeur du salarié en CDD si le CDI porte :
- sur un emploi identique ou similaire ;
- avec une rémunération au moins équivalente ;
- une durée de travail équivalente ;
- une classification et un lieu de travail identiques.
Du fait de la mention d’un emploi identique ou similaire, les contrats d’alternance semblent être exclus du dispositif.
Par l’entreprise utilisatrice si le CDI porte :
- sur le même emploi ou un emploi similaire à la mission
- avec un lieu de travail identique.
Ainsi, si un salarié refuse, au cours des 12 derniers mois, deux offres de CDI respectant les conditions citées ci-dessus, il pourra ne pas bénéficier des allocations d’assurance chômage.
Les exceptions au dispositif
Il existe deux exceptions à ce dispositif :
- si le salarié a été embauché en CDI au cours de cette même période.
- si les propositions faites ne respectent pas le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) et si le PPAE a été élaboré avant le dernier refus du salarié.
Dans ces deux cas, même si le salarié concerné a refusé deux propositions de CDI, il pourra bénéficier des allocations chômage.
Les formalités à respecter
Dans tous les cas, la proposition de CDI doit être réalisée par écrit avant le terme du CDD ou de la mission soit :
- Par recommandé avec avis de réception ;
- Par remise en main propre contre récépissé ;
- Par tout moyen donnant date certaine
Par ailleurs, il est prévu qu’un délai de réflexion doit être laissé au salarié pour accepter ou refuser la proposition de CDI.
Le courrier doit mentionner ce délai de réflexion accordé au salarié ainsi que la mention précisant que le silence vaudra refus.
Il est seulement fait mention que ce délai doit être un délai raisonnable. Il faut donc ainsi faire attention à ne pas fixer un délai trop court afin d’éviter tout contentieux. Nous conseillons de laisser 15 jours au salarié pour se prononcer.
L’information à France Travail
En cas de refus, l’employeur devra informer France Travail dans un délai de 1 mois.
Cette information s’effectue par voie dématérialisée à l’adresse suivante : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/refus-de-cdi-informer-francetravail
Elle doit être accompagnée du descriptif détaillé de l’emploi proposé ainsi que des éléments permettant de justifier que l’emploi proposé est identique ou similaire au précédent CDD, que la rémunération est au moins équivalente, que la durée de travail est équivalente, que la classification et le lieu de travail sont sans changement. Pour l’intérim, les justificatifs concernent uniquement la nature de l’emploi proposé ainsi que le lieu de travail.
Il faudra également faire mention du délai de réflexion laissé au salarié ainsi que, le cas échéant, la date de refus ou la date d’expiration du délai en cas d’absence de réponse du salarié.
A noter que France Travail pourra demander des éléments complémentaires. Dans ce cas, l’employeur aura 15 jours pour répondre.
Une fois l’information envoyée à France travail, l’organisme informera le salarié des conséquences légales de son refus sur ses allocations d’assurance chômage.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)


.svg)
.svg)
.svg)
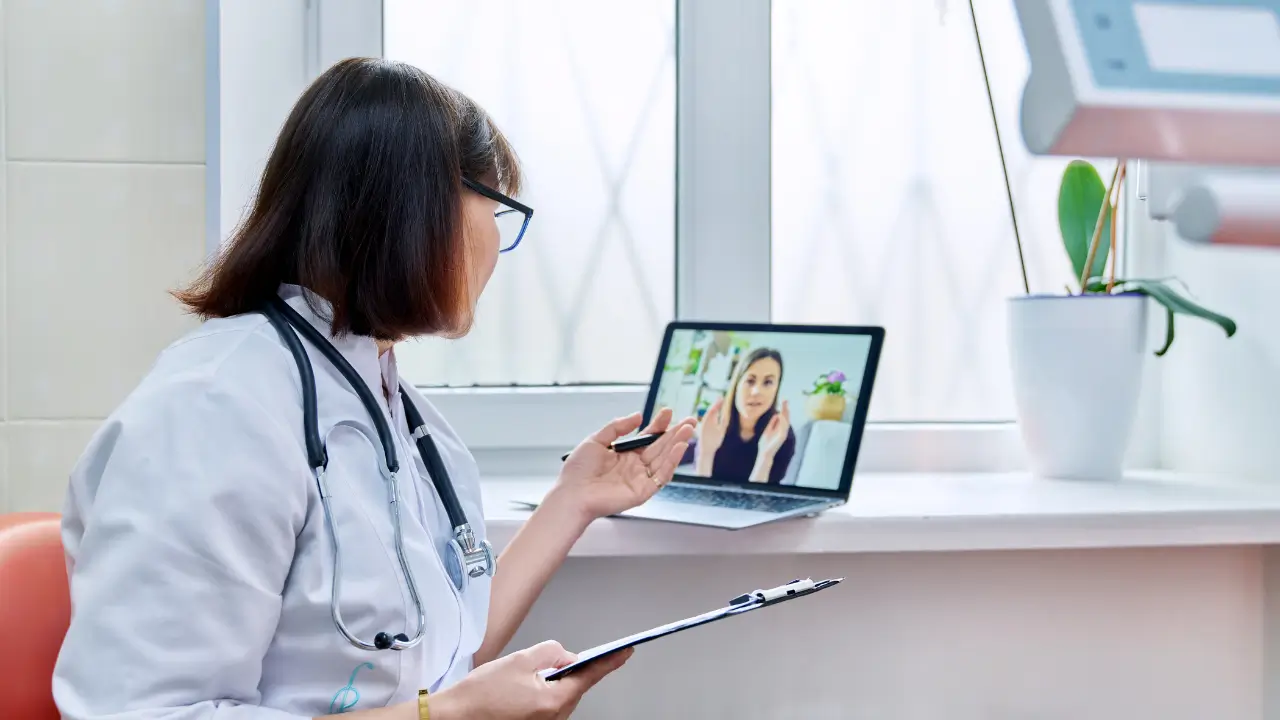










.svg)
