L'actualité paie RH, sociale et juridique des entreprises
Tenez vous informé des dernières évolutions et restez connecté !


Changement d’heure : le casse-tête annuel
Pour 2025, le passage à l’heure d'hiver est prévu dans la nuit du samedi 25 octobre au dimanche 26 octobre 2025.
Pour le passage à l’heure d’été, certains diront qu’on perd une heure, mais de manière simple : il faudra avancer la pendule d’une heure ! En bref, à 2 heures il sera en réalité 3 heures !
Au contraire, pour le passage à l’heure d’hiver, certains diront qu’on gagne une heure, mais de manière simple : il faudra reculer la pendule d’une heure ! En bref, à 3 heures il sera en réalité 2 heures !
Le droit du travail se trouve lui aussi impacté par ce changement d’heure, et notamment au niveau du décompte de la durée du travail des travailleurs de nuit.
Pas de panique ! On vous explique !
Pour trouver des réponses, il faut se reporter à une réponse ministérielle datant du 10 décembre 1976 (année de mise en place de la réforme !) et à une convention sur le changement d’heure.
1# Cas général
Pour le passage à l’heure d’hiver, la variation de l’heure va faire travailler le salarié une heure en plus, qui peut donc être une heure supplémentaire et être rémunérée comme telle et donner lieu à du repos.
Pour le passage à l’heure d’été, le changement d’heure diminue d’une heure le temps de travail. Dans cette hypothèse, l’employeur est en droit d’opérer une retenue correspondante sur le salaire du salarié.
2# Pour les salariés qui travaillent en équipe
Si ce ne sont pas les mêmes équipes qui travaillent lors des deux changements
Pour un salarié travaillant habituellement 8h/nuit :
- Pour le passage à l’heure d’hiver, il faudra payer les heures réellement effectuées (soit 1 heures en plus, si le salarié travaille 9 heures)
- Pour le passage à l’heure d’été, il faudra verser la rémunération classique correspondant à la durée de travail habituelle (8 heures, même s’ils n’en ont fait que 7).
Pour les employeurs qui font travailler les mêmes équipes lors des deux changements
La solution est plus simple. Il est possible de raisonner en durée globale et lissée, c’est-à-dire payer de manière « lissée ».
Pour les deux nuits concernées, l’heure effectuée en plus lors du changement d’hiver, sera compensée par celle effectuée en moins lors du changement d’été ! Les deux changements viennent alors s’équilibrer.
Attention ! Certains secteurs prévoient des règles particulières et spécifiques, comme par exemple la « Métallurgie » ou « Ports et manutention », il faut donc se référer aux dispositions conventionnelles.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)
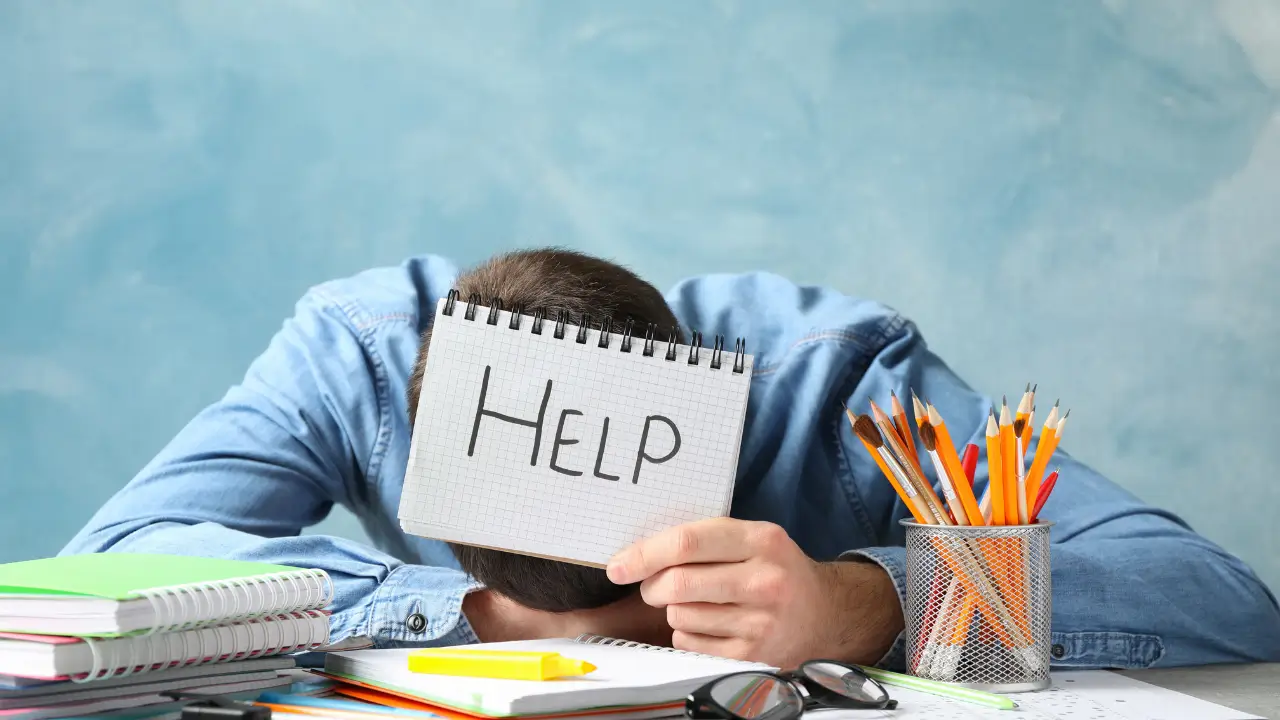
Prévenir le stress au travail : un impératif pour les employeurs
Le Ministère du travail a rédigé et mis en ligne le 25 septembre 2025 une fiche relative à la “prévention du stress au travail”.
Enjeu majeur de ces dernières années, la prévention des risques psycho-sociaux des travailleurs doit être un impératif pour les employeurs. Nous vous en disons plus !
Qu’est-ce que le stress professionnel ?
Le stress au travail se définit comme “un déséquilibre entre les contraintes imposées à un employé (objectifs, délais, pression, environnement, etc.) et sa perception de ses propres ressources pour y faire face.”
Selon l’Institut national de Recherche en Santé (INRS), physiologiquement le stress suit trois phases :
- Phase d’alarme : l’organisme se prépare à la réaction (combat/fuite).
- Phase de résistance : face à une situation stressante persistante, des efforts importants sont mobilisés.
- Phase d’épuisement : si la situation perdure ou s’intensifie, le salarié ne parvient plus à s’adapter, ce qui peut entraîner des conséquences graves pour la santé physique et mentale.
Pourquoi le stress professionnel est-il un enjeu crucial pour l’entreprise ?
Le stress ne touche pas uniquement l’individu : il est souvent le symptôme de dysfonctionnements organisationnels (processus, management, communication, conditions matérielles).
Par ailleurs, les conséquences de ce stress professionnel peuvent être graves : troubles musculo-squelettiques (TMS), troubles anxieux ou dépressifs, burn-out, qui peuvent entraîner, parfois, la reconnaissance de maladie professionnelle ou d’accident du travail et à terme une possible inaptitude. Pour en savoir plus sur les répercussions financières de l'inaptitude, vous pouvez consulter notre fiche pratique sur le sujet.
Enfin, le stress professionnel peut avoir des impacts économiques et humains importants pour une entreprise : absentéisme, turnover, perte de motivation, productivité réduite, climat social détérioré…
Obligations légales de l’employeur
L’employeur est tenu, en vertu de l'article L. 4121-1 du Code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale des salariés. Cela comprend ainsi la prévention des risques, l’information, la formation, l’adaptation des organisations selon l’évolution des risques.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) doit intégrer les risques psychosociaux (RPS), dont le stress.
Des accords nationaux (par exemple l’accord interprofessionnel relatif au stress de 2008) soulignent la nécessité d’une approche collective, d’anticiper, de diagnostiquer et de traiter le stress en entreprise.
Les facteurs de risques
La fiche du Ministère du travail identifie six grandes familles de facteurs qui favorisent stress et risques psychosociaux :
- Exigences du travail : surcharge ou sous-charge de travail, pression dans les délais demandés, objectifs flous ou irréalistes.
- Exigences émotionnelles : tâches impliquant de la charge émotionnelle, contact avec le public, gestion de la souffrance ou des émotions.
- Manque d’autonomie : absence de marge de manœuvre pour le salarié, contrôle excessif voire abusif.
- Rapports sociaux dégradés : isolement, rapports conflictuels, manque de soutien hiérarchique ou entre collègues.
- Conflits de valeurs : ce qui est demandé à faire à un salarié va à l’encontre des valeurs professionnelles de celui-ci.
- Insécurité socio-économique : instabilité de l’emploi, incertitudes sur l’avenir, manque de reconnaissance.
Ces facteurs peuvent s’exprimer à travers l’organisation du travail (horaires, charge, marge de manœuvre), les conditions de travail (environnement, ergonomie, nuisances), la communication (clarté des objectifs, des évolutions, des attentes) ainsi que les facteurs subjectifs (équilibre entre vie perso/pro, sentiment de ne pas être soutenu, reconnaissance, etc.).
Les leviers d’action pour l’employeur
Pour agir efficacement, le ministère identifie six axes principaux de prévention :
- Informer et former les travailleurs : sensibiliser aux signes de stress, aux outils de gestion, aux ressources internes ou externes.
- Réguler la charge de travail : éviter la surcharge, mieux gérer les délais et les objectifs, anticiper les pics d’activité.
- Garantir un soutien social solide : assurer un bon climat social, du soutien hiérarchique, des échanges entre collègues.
- Favoriser l’autonomie et la participation des salariés : permettre aux personnes concernées de contribuer aux décisions qui les affectent, donner du pouvoir d’action.
- Assurer une juste reconnaissance du travail : reconnaissance financière mais aussi symbolique, communication valorisante, retour d’information.
- Discuter des critères de qualité du travail : clarifier ce qu’est un travail bien fait, définir des critères clairs, cohérents, partagés.
Mise en œuvre pratique : démarche recommandée
- Cartographier / évaluer les risques
- Utiliser des questionnaires, audits ou entretiens pour identifier les points de tension dans l’entreprise, unité par unité.
- Intégrer les facteurs RPS dans le DUERP.
- Utiliser des questionnaires, audits ou entretiens pour identifier les points de tension dans l’entreprise, unité par unité.
Nous pouvons vous accompagner pour réaliser des audits organisationnels mais également vous aider dans la mise en place de la DUERP. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre site.
- Mettre en place un plan d’action collectif
- Prioriser les actions selon l’urgence et l’impact, en concertation avec les représentants du personnel.
- Réguler les dysfonctionnements de façon collective (favoriser la cohésion d’équipe, recourir au dialogue social…)
Définir des objectifs clairs, mesurables (réduction de l’absentéisme, enquête de climat, etc.).
- Former et sensibiliser
- Sensibiliser managers et équipes aux risques, aux signes de stress.
- Former les managers à une gestion bienveillante, à la délégation, à la communication.
- Sensibiliser managers et équipes aux risques, aux signes de stress.
Notre académie prévoit des formations pour apprendre à communiquer. Nous vous invitons à découvrir notre catalogue sur le sujet.
- Modifier l’organisation du travail
- Ajuster les charges et les délais, clarifier les objectifs.
- Revoir les procédures, les outils, l’environnement, afin de limiter les nuisances.
- Ajuster les charges et les délais, clarifier les objectifs.
- Renforcer le soutien
- Encourager le dialogue, les retours d’expérience.
- Mettre à disposition des ressources : cellules d’écoute ou d’assistance psychologique, soutien du service de santé au travail.
- Encourager le dialogue, les retours d’expérience.
- Suivre, ajuster, pérenniser
- Mettre en place des indicateurs de suivi : satisfaction, taux d’absentéisme, turnover, indicateurs de stress.
- Suivre la charge de travail et le respect de certains droits assurant l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle comme le droit à la déconnexion
- Assurer que les mesures restent adaptées au fil du temps (changements organisationnels, effectif, contexte économique, etc.).
Nous vous invitons également à consulter la fiche du Ministère du travail sur le sujet.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

Inaptitude : maladie professionnelle non reconnue, que faire ?
La gestion d’un licenciement pour inaptitude est déjà, en soi, un exercice délicat pour l’employeur. La difficulté s’accroît encore lorsque l’inaptitude du salarié est susceptible d’avoir une origine professionnelle.
Dans ce cas, la loi prévoit un régime protecteur renforcé, notamment en matière d’indemnisation. Mais que se passe-t-il lorsqu’un salarié a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sans que celle-ci n’ait été retenue par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ?
Une récente décision de la Cour de cassation (Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 24-15017 FS-D) apporte un éclairage utile pour les employeurs confrontés à cette situation.
Rappel : les conditions du licenciement pour inaptitude
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur peut engager une procédure de licenciement, mais uniquement dans trois hypothèses :
- impossibilité de proposer un emploi de reclassement adapté aux capacités restantes du salarié / aux recommandations du médecin du travail ;
- refus du reclassement proposé par le salarié, que la modification de son contrat soit substantielle ou non ;
- mention expresse du médecin du travail selon laquelle tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ou qu’aucune solution de reclassement n’est possible.
À ce stade, un élément crucial doit être identifié : l’origine de l’inaptitude. En effet, la nature professionnelle ou non professionnelle de l’inaptitude conditionne directement le régime d’indemnisation applicable.
Pour en savoir plus sur la gestion des salariés inaptes, consultez notre fiche pratique sur l’inaptitude.
Une protection renforcée en cas d’inaptitude professionnelle
Lorsqu’une inaptitude est liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié bénéficie d’un régime protecteur spécifique :
- une indemnité compensatrice équivalente à celle du préavis, même si ce dernier ne peut être exécuté ;
- une indemnité spéciale de licenciement, au moins égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Pour vous aider à calculer l’indemnité légale de licenciement, vous pouvez consulter notre fiche pratique dédiée à ce sujet.
Pour que ces règles protectrices s’appliquent, deux conditions doivent être réunies :
- l’inaptitude doit avoir, au moins en partie, pour origine une maladie ou un accident professionnel ;
- l’employeur doit avoir eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En pratique, cette seconde condition est centrale : si l’employeur n’a pas été informé du caractère professionnel de la pathologie, il n’est pas tenu d’appliquer le régime protecteur.
L’affaire jugée : une maladie non reconnue comme professionnelle
Dans l’affaire qui nous intéresse, un salarié avait déclaré à la CPAM une maladie professionnelle (hernie discale L5-S1) en octobre 2018. Or, la CPAM a refusé cette reconnaissance en septembre 2019. L’employeur a été informé de ce refus.
Par la suite, le salarié a été déclaré inapte en août 2020 et licencié en octobre 2020 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, il a demandé en justice la requalification en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, avec toutes les indemnités afférentes.
Son argument principal : l’employeur avait connaissance du caractère professionnel de sa pathologie, puisqu’il avait été informé de sa déclaration initiale à la CPAM. Selon lui, il importait peu que la CPAM ait refusé la reconnaissance : l’important était que l’inaptitude puisse être liée, au moins en partie, à une maladie professionnelle.
La position des juges : absence de preuve de connaissance par l’employeur
La cour d’appel, puis la Cour de cassation, ont rejeté cette argumentation. Elles ont relevé que :
- l’employeur avait bien été informé de la déclaration initiale, mais aussi du refus de prise en charge par la CPAM ;
- l’employeur n’avait pas été avisé du recours exercé par le salarié contre cette décision de refus ;
- les avis du médecin du travail ne faisaient aucune référence à une maladie professionnelle ;
- les arrêts de travail n’étaient pas produits et ne permettaient pas d’établir un lien avec une pathologie professionnelle.
En conséquence, au moment du licenciement, rien ne permettait d’affirmer que l’employeur avait connaissance d’une origine professionnelle de l’inaptitude. Dès lors, le régime protecteur ne s’appliquait pas, et le licenciement pour inaptitude non professionnelle était valable.
Enseignements pratiques pour les employeurs
Cette décision illustre un point essentiel : la charge de la preuve de l’origine professionnelle de l’inaptitude et de la connaissance par l’employeur incombe au salarié.
Pour les employeurs, plusieurs recommandations se dégagent :
- Vérifier l’état des procédures auprès de la CPAM : si une reconnaissance de maladie professionnelle est en cours ou a été actée, il est indispensable d’en tenir compte dans la gestion du dossier.
- S’appuyer sur les avis du médecin du travail : en l’absence de mention d’une pathologie professionnelle, la présomption joue plutôt en faveur d’une inaptitude non professionnelle.
- Conserver les échanges et décisions officielles : notamment les notifications de la CPAM, qui peuvent démontrer l’absence de reconnaissance.
- Ne pas anticiper une origine professionnelle sans décision claire : si la maladie n’a pas été reconnue et qu’aucun élément nouveau n’a été communiqué, l’employeur n’est pas tenu d’appliquer le régime renforcé.
- Documenter la procédure de reclassement : comme toujours en matière d’inaptitude, la preuve des recherches et des propositions de reclassement est indispensable.
Conclusion
Le licenciement pour inaptitude est un terrain délicat pour l’employeur, et la question de l’origine de l’inaptitude en est un point de tension majeur. La jurisprudence rappelle que la protection liée à l’inaptitude professionnelle ne s’applique que si l’employeur a eu connaissance effective de cette origine au moment de la rupture.
Dans l’affaire jugée en septembre 2025, l’absence de reconnaissance de la maladie professionnelle, le défaut d’information de l’employeur sur un éventuel recours et l’absence de preuve indiquant que l'employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ont conduit les juges à valider le licenciement pour inaptitude non professionnelle.
Si vous souhaitez lire la décision de la Cour de cassation, vous pouvez la retrouver sur le site de la Cour de cassation.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

Réduction générale dégressive unifiée (RGDU) : ce qui change en 2026
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) de 2025 a opéré une réforme en profondeur des allégements généraux de cotisations patronales, dont l’objectif affiché est une économie de 1,6 milliards pour l’Etat.
Une première modification des taux applicables a eu lieu en 2025, en préalable à une refonte complète annoncée en 2026 et dont les modalités devaient être précisées par décret.
Le décret n° 2025-887 paru le 4 septembre 2025 donne enfin les contours de cette réforme, applicable dès le 1er janvier 2026. Les principaux changements apportés sont les suivants :
La fusion des allègements
La réduction générale de cotisations patronales (RGCP) est remplacée par la réduction générale dégressive unifiée (RGDU).
Le nouveau plafond d’éligibilité
La nouvelle réduction s’appliquera aux revenus d’activité inférieurs à 3 SMIC. Pour sécuriser vos pratiques, consultez notre fiche pratique sur la rémunération minimale et le SMIC.
Pour rappel, actuellement les plafonds sont les suivants :
- Assurance maladie : 2,25 SMIC
- Allocations familiales : 3,3 SMIC
- Réduction générale (RGCP) : 1,6 SMIC
La valeur du SMIC
Le SMIC à prendre en compte n’est plus un SMIC figé mais le SMIC en vigueur, que ce soit pour le plafond d’éligibilité ou pour le calcul de la RGDU. Retrouvez aussi notre fiche pratique sur le traitement de la CSG-CRDS, directement impactée par l’évolution des assiettes sociales.
La nouvelle formule de calcul
La réduction est calculée par salarié et sur l’année civile. Les primes et indemnités reçues en cours d’année peuvent réduire l’allégement et entraîner une reprise.
Le principe reste celui d’une réduction maximale au niveau du SMIC, puis dégressive jusqu’à être nulle pour une rémunération égale à 3 SMIC.
Le coefficient de réduction sera obtenu par application de la formule suivante :
Coefficient = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × Smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1)]1,75)
Valeurs du coefficient de réduction selon le taux de FNAL de l’entreprise :
- Pour un taux de FNAL de 0,10 % :
- Tmin = 0,0200
- Tdelta = 0,3773
- Tmax = 0,3973
- Pour un taux de FNAL de 0,50 % :
- Tmin = 0,0200
- Tdelta = 0,3813
- Tmax = 0,4013
Il ressort de cette formule que :
- La valeur maximale du coefficient est augmentée pour tenir compte de la suppression des taux réduits sur les cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales.
- Le seuil minimal d’exonération égal à 2%.
- La valeur maximale du coefficient correspond à la somme de Tmin et Tdelta
- La dégressivité de la réduction est renforcée par la puissance « P », dont la valeur est fixée à 1,75.
Précision sur l’entrée/sortie et la suspension du contrat
Le décret précise qu’en cas d’entrée/sortie en cours d’année ou de suspension du contrat sans maintien intégral de la rémunération, la fraction du montant du salaire minimum de croissance est corrigée selon le rapport entre les revenus d’activité dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois. Pour approfondir ce sujet, consultez notre fiche pratique sur le maintien de salaire légal.
Pour présenter ces nouvelles dispositions, le BOSS a annoncé la création de deux nouvelles rubriques prochainement.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

Bonus-malus sur la cotisation chômage
Afin d’inciter les entreprises à employer durablement les salariés et à pénaliser la succession de contrats courts dans certains secteurs d’activité, le règlement d’assurance chômage a instauré un mécanisme de bonus-malus sur la cotisation patronale.
De quoi parle-t-on ?
Le règlement d’assurance chômage a instauré un nouveau mécanisme de bonus-malus sur la cotisation patronale d’assurance chômage.
Ainsi, le taux de contribution de chaque employeur peut être majoré ou minoré en fonction :
- de la taille de l’entreprise
- du secteur d’activité de l’entreprise
- de la nature du contrat de travail, de sa durée, de son motif de recours
- du nombre de fins de contrats de travail et de contrats de mise à disposition (à l’exclusion des démissions et des contrats de mission) et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi
Pour bien maîtriser ces paramètres, consultez notre fiche pratique sur les durées de travail.
Pour schématiser : plus une entreprise a recours à des contrats précaires, plus son taux de contribution chômage sera élevé. Au contraire, plus une entreprise a recours à des contrats pérennes, moins elle paiera de contribution chômage.
Pour la 4e période commençant le 1er septembre 2025, il sera tenu compte de nombre de séparations imputables à l’entreprise et intervenues du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
Du fait de la fluctuation de la contribution, on parlera de taux modulé.
Qui est concerné ?
Le dispositif de bonus-malus concerne pour l’instant les entreprises d‘au moins 11 salariés et appartenant l’un des 7 secteurs suivants :
- Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac
- Transports et entreposage
- Hébergement et restauration
- Travail du bois, industries du papier et imprimerie
- Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques
- Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Quel impact sur la cotisation patronale chômage ?
La cotisation patronale chômage est en principe de :
- 4.05% jusqu’au 30/04/2025
- 4.00% à compter du 01/05/2025
Avec ce nouveau dispositif, ce taux pourra être modulé de la manière suivante :
- pour les entreprises en bonus, le taux pourra descendre à 3% jusqu’au 30/04/2025 et 2.95% à compter du 01/05/2025
- pour les entreprises en malus, le taux pourra atteindre 5.05% jusqu’au 30/04/2025 et 5% à compter du 01/05/2025.
Pour sécuriser vos pratiques, appuyez-vous sur notre fiche pratique sur le traitement de la CSG-CRDS.
Pour déterminer ce taux, la modulation se fera en fonction du taux de séparation de l’entreprise (c’est-à-dire les fins de contrats qui lui sont imputables) et le taux de séparation médian de son secteur d’activité. Ce dernier sera fixé chaque année par arrêté.
Pour quelles périodes ?
En principe, le dispositif du bonus-malus s’applique aux périodes d’emploi du 1er mars N jusqu’au 28/29 février N+1.
Pour la première année d’application, il a été mis en œuvre sur une période d’emploi allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
Le second cycle va quant à lui du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.
Une 3e période de modulation a été décrétée. A l’heure actuelle, cette dernière commence du 1er septembre 2024 et se termine le 31 décembre 2024. La convention d’assurance chômage a prolongé cette 3e période jusqu’au 31 août 2025.
Une 4e période de modulation s’est ouverte au 1er septembre 2025. Elle prendra fin, en principe, au 28 février 2026.
Quand est-ce que les employeurs seront informés de leur taux ?
Le taux de séparation et le taux de contribution modulé seront en principe notifiés à l’employeur par voie dématérialisée par les organismes chargés du recouvrement de la contribution (URSSAF, MSA ou CGSS) au plus tard 15 jours après le début de la période d’emploi au cours de laquelle s’applique la modulation du taux.
Pour la période d’emploi qui va commencer au 1er septembre 2025, la notification des taux modulés a déjà été effectuée entre le 29 et le 31 août 2025 par l’intermédiaire des comptes-rendus métier DSN. L’URSSAF, quant à lui, devrait notifier les taux d’ici le 5 septembre 2025.
Pour les entreprises qui ne connaitraient pas leur taux modulé alors qu’ils en ont besoin pour calculer les cotisations du solde de tout compte (ex : ruptures de contrats intervenant début septembre 2024), il sera admis que le taux de cotisation appliqué ne tienne pas compte de la modulation.
Quel est le taux de séparations médians par secteur ?
Pour la période du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, les taux médians de séparation par secteur d’activité sont les suivants :
- Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits de base de tabac : 189,82 %
- Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution : 57,52 %
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques : 7,33 %
- Hébergement et restauration : 67,59 %
- Transports et entreposage : 47,77 %
- Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques : 87,18 %
- Travail du bois, industries du papier et imprimerie : 93,93 %
Est-il possible de demander des précisions à l'URSSAF concernant les contrats influençant le taux ?
Oui depuis le 22 juillet 2023. Un téléservice a également été mis en place le 1er octobre 2023. En cas de retenues ou régularisations, reportez-vous à notre fiche pratique sur la saisie sur salaire pour comprendre les règles applicables.
À la demande de l’employeur ou de son tiers déclarant, les URSSAF peuvent fournir une liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, dont la fin de contrat est imputable à l’employeur.
La demande se fait par voie dématérialisée via un téléservice. Si l’utilisation du téléservice n’est pas possible, l’employeur ou son tiers déclarant peut faire cette demande par tout autre moyen.
Le décret établit également les fondements juridiques du traitement des données personnelles nécessaires pour assurer cette transmission, en spécifiant les finalités du traitement, les catégories de données traitées, les personnes autorisées à y accéder, les destinataires des données, leur durée de conservation et les procédures pour exercer les droits prévus par le RGPD pour les personnes concernées.
L’URSSAF a publié un « guide du déclarant » que vous pouvez consulter ici
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)


.svg)
.svg)
.svg)
.webp)











.svg)
